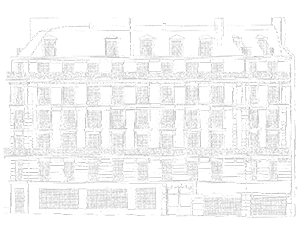faut-il que tout change pour que rien ne change ?
A l’occasion de la transposition de la Directive sur les actions représentatives, le Parlement a achevé la refonte globale du droit de l’action de groupe initiée en 2020 avec le rapport d’information Gosselin- Vichnievsky.
La nouvelle loi harmonise et renforce ce droit naissant mais discuté depuis plus d’un demi-siècle. Si le texte contient d’incontestables avancées, il ne s’agit pas d’un changement de paradigme et encore moins d’une révolution.
Le chemin est encore long pour doter la France d’une véritable « class action » permettant de remplir la promesse de faciliter l’accès à la justice.
Au-delà de la nécessaire protection des consommateurs et des citoyens qui peuvent s’unir pour défendre leurs droits, il s’agit de doter la France d’un outil efficace de régulation économique afin d’assurer la souveraineté judiciaire et éviter ainsi une dévitalisation (pour ne pas dire une « désindustrialisation ») de la place de Paris.
La loi prévoit d’établir un bilan de la réforme dans quatre ans. C’est le temps qu’il nous reste pour inventer une procédure idéale qui pourrait donner à « Paris place du droit » ses lettres de noblesse pour l’action de groupe comme cela a été fait pour l’arbitrage et ainsi rivaliser avec Amsterdam ou Milan qui tentent d’attraire dans leur for les class-actions européennes.
Télécharger l'intégralité de l'article
INTRODUCTION
1. Le monde a changé mais le droit (français) refuse-t-il de le reconnaître ? - Dans son article de référence[[1]]url:#_ftn1 , datant de 1975, le professeur Mauro Cappelletti commençait par citer le professeur Roger Perrot constatant, dès 1969, que « La théorie de l'action en justice a été élaborée au XIXème siècle dans une perspective libérale et individualiste. Il était donc normal que la généralisation des groupements de toute sorte, qui est la marque de nos économies modernes, entraînât de nombreux problèmes d'adaptation »[[2]]url:#_ftn2 . Puis, il ajoutait un commentaire tout à la fois pratique et économique « La complexité de la société moderne et l'enchevêtrement des relations économiques engendrent des situations où des actes particuliers peuvent porter atteinte aux intérêts d'un grand nombre de personnes et présentent, de ce fait, des problèmes qui n'ont pas été envisagés dans les litiges individuels. Le danger de ces dommages, qui affectent simultanément plusieurs individus, constitue un phénomène croissant et fréquent dans les sociétés industrielles. Les personnes ainsi lésées sont souvent dans des conditions inadéquates pour obtenir la protection juridictionnelle contre les préjudices individuellement subis. Elles peuvent même ignorer leurs droits. Leurs prétentions individuelles peuvent être trop minimes. En outre, le risque d'encourir de gros frais engendrés par le procès peut être disproportionné par rapport au dédommagement possible ».
2. Accord partagé sur le constat mais timidité des solutions proposées - A la lecture des deux premiers paragraphes du préambule[[3]]url:#_ftn3 de la directive (UE) 2020/1828 du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs (ci-après la « Directive »)[[4]]url:#_ftn4 , on pourrait croire que ce constat est partagé par tous. Rien n’est moins sûr tant l’action collective heurte des intérêts puissants, des conservatismes frileux et des réactionnaires qui souhaitent déconstruire, sans le dire ouvertement, les acquis de l’État providence et de la Grande Société[[5]]url:#_ftn5 . Ainsi, en droit français, on s’est longtemps retranché derrière l’adage « nul ne plaide par procureur », pour limiter le droit d’action collective des associations, tout en reconnaissant la validité des actions regroupées[[6]]url:#_ftn6 . En France comme dans l’Union européenne, l’adaptation du droit processuel a été particulièrement longue. La procédure de « class action » américaine[[7]]url:#_ftn7 était souvent présentée comme un épouvantail pour les entreprises[[8]]url:#_ftn8 , notamment en raison de l’existence de la procédure de discovery, qui peut s’avérer particulièrement onéreuse, ainsi que des punitive damages (dommages et intérêts punitifs) qui permettent de sanctionner une conduite jugée particulièrement répréhensible tout en dissuadant d’autres entreprises d’adopter des comportements similaires. La Directive écarte avec effroi cette possibilité en précisant : « Il est important d’assurer l’équilibre nécessaire entre améliorer l’accès des consommateurs à la justice et fournir des garanties appropriées aux professionnels afin d’éviter les recours abusifs qui entraveraient de manière injustifiée la capacité des entreprises à exercer leurs activités sur le marché intérieur. Pour empêcher l’utilisation abusive des actions représentatives, il convient d’éviter l’octroi de dommages et intérêts punitifs et de fixer des règles sur certains aspects procéduraux, comme la désignation et le financement d’entités qualifiées ». (§ 10 du préambule).
3. Les cinq piliers de l’action représentative - Le cadre européen porté par la Directive repose sur 5 principes :
3.1 Premier principe : l’affirmation d’une subsidiarité multiforme – Face à la création d’une procédure unique pour tous les États membres, la Directive préfère la voie plus étroite et plus souple de l’harmonisation. Ainsi, à plusieurs reprises, la Directive affirme le principe de subsidiarité qu’elle décline pour les Entités qualifiées[[9]]url:#_ftn9 comme pour les États-membres.
Pour les demandeurs, à l’origine d’une action représentative transnationale, l’article 1-3°) de la Directive dispose que « Les entités qualifiées sont libres de choisir tout moyen procédural à leur disposition en vertu du droit de l’Union ou du droit national pour protéger les intérêts collectifs des consommateurs ». Ainsi, le recours à une action représentative n’est pas obligatoire. D’autres procédures sont possibles (au civil, action collective conjointe ; au pénal, plainte ou citation directe, par exemple).
Pour les États membres, « la directive laisse une importante marge de manœuvre aux législateurs nationaux. Derrière un même et unique texte européen, c’est donc une myriade de mécanismes procéduraux de nature très diverse et à l’efficacité variable qui s’apprêtent à voir le jour en Europe »[[10]]url:#_ftn10 . Ainsi, à plusieurs reprises, le préambule de la Directive affirme que « Conformément au principe de l’autonomie procédurale, la présente directive ne devrait pas comporter de dispositions sur chaque aspect de la procédure applicable aux actions représentatives. Par conséquent, il appartient aux États membres de fixer des règles, par exemple sur la recevabilité, la preuve ou les voies de recours, applicables aux actions représentatives » (§ 12).
De même, en ce qui concerne la question du recours à une procédure opt-in / opt-out[[11]]url:#_ftn11 , il est précisé que « Afin de répondre au mieux à leurs traditions juridiques, les États membres devraient prévoir un mécanisme de participation ou un mécanisme de non-participation, ou une combinaison des deux. Dans un mécanisme de participation, les consommateurs devraient être tenus d’exprimer explicitement leur volonté d’être représentés par l’entité qualifiée dans le cadre de l’action représentative visant à obtenir des mesures de réparation. Dans un mécanisme de non-participation, les consommateurs devraient être tenus d’exprimer explicitement leur volonté de ne pas être représentés par l’entité qualifiée dans le cadre de l’action représentative visant à obtenir des mesures de réparation. Les États membres devraient pouvoir décider à quel stade de la procédure les consommateurs individuels peuvent exercer leur droit de participer ou de ne pas participer à une action représentative » (§43).
Dernière forme de subsidiarité, l’article 2-3°) affirme que « La présente directive est sans préjudice des règles de l’Union en matière de droit international privé, en particulier des règles relatives à la compétence ainsi qu’à la reconnaissance et à l’exécution des décisions en matière civile et commerciale et des règles relatives au droit applicable aux obligations contractuelles et non contractuelles.
Ces exemples confirment que la directive ne vise pas à uniformiser les règles de droit entre tous les États membres mais à harmoniser les procédures afin de renforcer la confiance des consommateurs, contribuer à une concurrence plus équitable et instaurer des conditions homogènes pour les professionnels exerçant leurs activités sur le marché intérieur (§ 7 du préambule).
3.2 Deuxième principe : les actions représentatives ont un objet doublement limité – Tant le titre, le préambule (notamment les § 5, 19, et 33) ainsi que l’article 1-1 de la Directive affirment que l’action représentative vise à « à protéger les intérêts collectifs des consommateurs ». Deux expressions doivent retenir notre attention, l’« intérêt collectif » et les « consommateurs ».
La notion d’intérêt collectif s’oppose aux intérêts individuels. Plus précisément, l’article 3-3°) de la Directive définit l’intérêt collectif comme « l’intérêt général des consommateurs et, en particulier aux fins des mesures de réparation, les intérêts d’un groupe de consommateurs ». Cet intérêt est bafoué chaque fois que des infractions au droit de l’Union ou une pratique[[12]]url:#_ftn12 illicite réduisent ou effacent les droits des consommateurs. L’article 2-1°) précise que l’action représentative « s’applique aux infractions nationales et transfrontières, y compris lorsque ces infractions ont cessé avant que l’action représentative n’ait été intentée ou lorsque ces infractions ont cessé avant que l’action représentative n’ait été close ».
La notion de consommateur est définie comme « toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale (article 3-1°). Cette définition exclut les personnes morales de droit privé (une société commerciale, par exemple) comme les personnes morales de droit public (une collectivité locale ou un établissement public).
Si l’Annexe 1 de la Directive définit le droit européen de la consommation de matière très large (cf. Tableau), il n’en demeure pas moins que les actions représentatives en droit de l’environnement ou en droit social ne sont pas visées. Ainsi, depuis la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, le domaine d’application de l’action de groupe en France est plus large que celui de l’action représentative en raison de l’extension au droit de l’environnement et aux discriminations au travail. Selon nous, une action représentative transfrontière ne peut concerner que les sujets circonscrits par la Directive.
3.3 Troisième principe : la Directive prévoit deux types d’actions représentatives : les actions nationales et les actions transfrontières - Le § 23 du préambule précise que « Lorsqu’une entité qualifiée intente une action représentative dans un État membre autre que celui où elle est désignée, cette action représentative devrait être considérée comme une action représentative transfrontière. Lorsqu’une entité qualifiée intente une action représentative dans l’État membre dans lequel elle est désignée, cette action représentative devrait être considérée comme une action représentative nationale, même si elle est intentée à l’encontre d’un professionnel domicilié dans un autre État membre et même si des consommateurs de plusieurs États membres sont représentés dans le cadre de cette action représentative ». La Directive prévoit une étanchéité entre les deux types d’actions. En effet, le § 23 in fine ajoute que « L’État membre dans lequel l’action représentative est intentée devrait être le critère décisif pour déterminer le type d’action représentative intentée. Pour cette raison, il ne devrait pas être possible qu’une action représentative nationale devienne une action représentative transfrontière au cours de la procédure ou vice-versa ». Les actions représentatives transfrontière ne peuvent être initiée que par des « entités qualifiées désignée à l’avance » (Article 6-1). La Directive reconnaît un mode simplifié de preuve de la qualité pour agir. En effet, l’article 5-1 prévoit que chaque État membre communique à la Commission européenne sa liste des entités qualifiées. L’article 6-3 considère que la présente sur cette liste constitue une preuve suffisante de la qualité pour agir en vue d’intenter une action représentative transfrontière « sans préjudice du droit de la juridiction ou de l’autorité administrative saisie d’examiner si l’objet statutaire de l’entité qualifiée justifie qu’elle introduise une action dans une affaire déterminée ».
3.4 Quatrième principe : double finalité, cessation d’un manquement ou réparation - la finalité de l’action représentative peut être double soit faire cesser un manquement « indépendamment du fait que des consommateurs individuels subissent ou non une perte ou un préjudice réels » (§ 33). L’article 8-1 demande aux États membres de veiller à ce que les mesures de cessation soient disponibles sous la forme « a) d’une mesure provisoire ordonnant la cessation d’une pratique ; b) d’une mesure définitive ordonnant la cessation d’une pratique ou, le cas échéant ». Par ailleurs, il doit être possible d’assortir la pratique litigieuse d’une interdiction, lorsqu’il a été établi que cette pratique constitue une infraction commise « par des professionnels aux dispositions du droit de l’Union visées à l’Annexe I, y compris ces dispositions telles qu’elles ont été transposées en droit national, qui portent atteinte ou risquent de porter atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs » (article 2-1 de la Directive).
Par mesure de réparation, la Directive vise large puisqu’elle entend « une mesure qui ordonne à un professionnel d’offrir aux consommateurs concernés des modes de dédommagement tels que l’indemnisation, la réparation, le remplacement, la réduction du prix, la résolution du contrat ou le remboursement du prix payé, selon le cas et selon ce que prévoit le droit de l’Union ou le droit national » (article 3-10). On retrouve à l’article 9-2 la grande liberté laissée aux États membres, à qui il leur appartient de fixer les « règles indiquant comment et à quel stade d’une action représentative visant à obtenir des mesures de réparation les consommateurs individuels concernés par ladite action représentative expriment explicitement ou tacitement, dans un délai approprié après l’introduction de l’action représentative, leur volonté d’être représentés ou non par l’entité qualifiée dans le cadre de ladite action représentative et d’être liés ou non par l’issue de cette action ». La directive n’impose pas de choix entre l’opt-in et l’opt-out (article 9-3 et s.). L’article 11 organise l’accord concernant la réparation en prévoyant une procédure d’homologation par une juridiction ou une autorité administrative qui doit refuser d’homologuer un accord qui est contraire aux dispositions impératives de droit national ou qui comporte des conditions qui ne peuvent pas être exécutées, compte tenu des droits et des intérêts de toutes les parties, et en particulier ceux des consommateurs concernés (article 11-2). L’article 12 fixe les principes d’allocation des frais d’une action représentative si la partie succombante dans une action représentative visant à obtenir des mesures de réparation est tenue de payer les frais de procédure supportés par la partie qui obtient gain de cause[[13]]url:#_ftn13 , conformément aux conditions et exceptions prévues par le droit national applicable à la procédure judiciaire en général (article 12-1), les consommateurs individuels concernés par une action représentative visant à obtenir des mesures de réparation ne paient pas les frais de procédure (article 12-2) sauf « en raison [leur] comportement intentionnel ou négligent » (article 12-3).
3.5 Cinquième principe : reconnaissance de la licéité du financement de l’action représentative par un tiers sous réserve de maintenir l’indépendance de l’entité qualifiée – L’article 10 de la Directive est consacré au financement des actions représentatives visant à obtenir des mesures de réparation. La reconnaissance d’un tel mode de financement par les tiers rejaillit sur les exigences d’indépendance des Entités qualifiées. Ainsi, l’article 10-1 prévoit que le financement par des tiers ayant un intérêt économique dans l’introduction ou l’issue de l’action représentative visant à obtenir des mesures de réparation ne doit pas détourner pas l’action représentative de la protection des intérêts collectifs des consommateurs. Plusieurs dispositions précisent les règles relatives à l’indépendance structurelle des entités qualifiées, de l’absence d’influence du tiers financeur qui porterait préjudice aux intérêts collectifs des consommateurs ou aux procédures à mettre en place pour prévenir tout conflit d’intérêts. Ainsi, il n’est pas possible que la décision de participer à une transaction soit prise par le tiers financeur. L’article 10-2b) prohibe l’action représentative intentée « contre un défendeur qui est un concurrent du bailleur de fonds ou contre un défendeur dont le bailleur de fonds dépend ».
Il appartient à la juridiction ou à l’autorité administrative chargée de l’homologation à vérifier cette situation. Ainsi, la juridiction ou à l’autorité administrative chargée de l’homologation doit pouvoir « prendre les mesures appropriées, par exemple exiger de l’entité qualifiée qu’elle refuse le financement en question ou y apporte des modifications et, si nécessaire, rejeter la qualité pour agir de l’entité qualifiée dans le cadre d’une action représentative déterminée. Si la qualité pour agir de l’entité qualifiée est rejetée dans le cadre d’une action représentative déterminée, ce rejet ne porte pas atteinte aux droits des consommateurs concernés par ladite action représentative » (article 11-3 et 4).
De manière plus générale, le § 25 de la Directive recommande que les entités qualifiées soient « soumises aux mêmes critères de désignation dans l’ensemble de l’Union ». Cela se justifie, notamment, parce qu’une entité qualifiée peut agir en dehors de son État membre dans le cadre d’une action transnationale. L’article 4 détaille les conditions requises : des personnes morales régulièrement constituées conformément au droit national de l’État membre de désignation, ayant un certain degré de permanence et un certain niveau d’activité publique, poursuivant un but non lucratif et ayant un intérêt légitime, eu égard à leur objet statutaire, à protéger les intérêts des consommateurs comme le prévoit le droit de l’Union. Les entités qualifiées ne doivent pas faire l’objet d’une procédure d’insolvabilité ou être déclarées insolvables. L’article 4-3-e) insiste sur leur indépendance et l’absence d’influencées « par des personnes autres que des consommateurs, qui ont un intérêt économique dans l’introduction d’une action représentative, en particulier des professionnels ou des fonds spéculatifs, y compris en cas de financement par des tiers ». Ainsi, la Directive prévoit que les entités qualifiées doivent mettre en place « des procédures pour prévenir une telle influence ainsi que pour prévenir les conflits d’intérêts entre elles-mêmes, leurs bailleurs de fonds et les intérêts des consommateurs ». Enfin, l’article 4-2-f) prévoient un devoir de transparence et d’information qui se traduit par la « mise à disposition du public, en des termes clairs et compréhensibles, par tout moyen approprié, en particulier sur leurs sites internet, des informations démontrant qu’elles satisfont aux critères de désignation en tant qu’entités qualifiées et des informations générales sur les sources de leur financement en général, leur structure organisationnelle, de gestion et d’affiliation, leur objet statutaire et leurs activités ».
4. Dans son étude, Omar Kafi-Cherrat[[14]]url:#_ftn14 souligne à juste titre que la Directive est le fruit de « plusieurs années de débats, tant juridiques que politiques[[15]]url:#_ftn15 » ayant abouti à un texte « aussi imparfait soit-il » qui constitue « une avancée dans la voie de l’effectivité des droits conférés aux consommateurs par le droit de l’Union ». Cette double remarque pourrait être transposée aux débats parlementaires français relatifs à l’action de groupe (I- La procédure parlementaire entre surprises et compromis). En présentant de manière détaillée, la loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dite « DDADUE »[[16]]url:#_ftn16 , l’objectif est de mettre au clair le droit positif de l’action de groupe en en passant au crible une loi complexe, fruit d’un intense travail parlementaire et d’un compromis entre les deux chambres (II- La « nouvelle » action de groupe). Enfin, dans une dernière partie, la loi sera mise sous tension d’une critique croisée des principaux acteurs pour tenter d’élaborer des perspectives d’évolution qui nous paraissent à recommander (III – Critiques croisées et perspectives ambitieuses : pour une class action éthique européenne, à paraitre ultérieurement).
* *
*
5. Un important retard dans la transposition de la directive « actions représentatives » La Directive aurait dû être transposée, en France, avant le 25 décembre 2022. Ses dispositions auraient dû entrer en application en droit interne à compter du 25 mai 2023. Souvent le législateur français se méprend sur l’étendue de la Directive. Ainsi, contrairement à l’affirmation de Charles Sitzenstuhl[[17]]url:#_ftn17 , l’action représentative n’est pas destinée à « réparer un préjudice de faible valeur monétaire ». En effet, les actions en réparation, en matière de responsabilité des produits défectueux ou celles relatives aux pratiques anticoncurrentielles, peuvent donner prise à des indemnisations significatives.
6. Une directive d’harmonisation - Comme le remarque Charles Sitzenstuhl, la Directive met en place « un régime juridique européen soucieux des particularités nationales ». Outre la création d’une action en cessation de manquement (article 8), la Directive prévoit les règles propres à assurer la réparation (article 9). Le rapporteur de la Commission Affaires européennes souligne que « l’apport le plus important repose sur la création des actions transfrontières ». Ainsi, la « directive repose sur un double constat : la mauvaise indemnisation des préjudices en raison de la fragmentation des systèmes juridiques et le besoin de redonner confiance au consommateur par la mise en place d’une législation avec des effets concrets ». Pour autant et « afin d’éviter abus et embolie du système judiciaire », la Directive a prévu plusieurs verrous, dont le principal est de réserver le droit d’action à des « entités qualifiées » sous contrôle d’une autorité nationale. Si les États membres demeurent libres de déterminer les critères d’habilitation, la délivrance de cette qualité représente un véritable passeport européen en raison du principe de reconnaissance mutuelle. Selon Charles Sitzenstuhl, la Directive prend grand soin de ne pas imposer un mécanisme d’action : entre la participation (opt-in) ou bien la non-participation (opt-out), le choix est variable suivant les États membres[[18]]url:#_ftn18 : « Dans le cas des actions en réparation, la possibilité est laissée aux États de choisir le mécanisme à privilégier même si le texte encourage néanmoins la participation jugée plus protectrice des droits du consommateur. En revanche, dans le cas d’actions en cessation, l’opt–in est rendu obligatoire » [[19]]url:#_ftn19 .
7. D’une transposition simple… - Initialement le gouvernement avait fait le choix d’une « transposition simple » dans le cadre d’une loi fourre-tout portant diverses mesures de transposition (15 pages sur les 136 pages du projet de loi[[20]]url:#_ftn20 ). Cette simplicité s’illustre dans l’absence d’observations sur la partie relative à l’action de groupe dans l’avis du Conseil d’État relatif à ce projet de loi de rattrapage[[21]]url:#_ftn21 . Par ailleurs, l’étude d’impact[[22]]url:#_ftn22 pouvait apparaitre sommaire et se bornait à affirmer que le retard de transposition était limité car il existait déjà différents régimes d’actions de groupe intégrés dans le droit positif[[23]]url:#_ftn23 . Pourtant, à l’approche du dixième anniversaire de la loi Hamon[[24]]url:#_ftn24 , dans leur rapport d’information[[25]]url:#_ftn25 deux députés (Laurence Vichnievsky et Philippe Gosselin) avaient établi que le bilan de l’action de groupe était « décevant »[[26]]url:#_ftn26 . Ils avaient souligné la faible réception de cet outil procédural (une vingtaine de procédures en 10 ans) qui n’avait pas été adopté en raison de l’ « excessive complexité »[[27]]url:#_ftn27 des différents régimes. Ils avaient identifié plusieurs points de blocage, dont le principal est la qualité à agir. Ils avaient formulé treize propositions[[28]]url:#_ftn28 qu’ils traduisirent dans une proposition de loi[[29]]url:#_ftn29 . Fait remarquable, leur texte bien qu’imparfait, était adopté, le 8 mars 2023, à l’unanimité de l’Assemblée nationale[[30]]url:#_ftn30 . Cette proposition de loi comprenait tout un volet de transposition de la Directive et notamment les dispositions relatives à l’action transfrontière. Mais, n’étant pas au goût du Sénat, ou plutôt des intérêts des grandes entreprises[[31]]url:#_ftn31 , la commission des lois, menée par M. Christophe-André Frassa, son rapporteur[[32]]url:#_ftn32 , détricota le texte[[33]]url:#_ftn33 et le vida de toutes ses avancées[[34]]url:#_ftn34 . De retour à l’Assemblée, le texte est renvoyé dans les caves du Palais Bourbon en raison de la dissolution inattendue de l’Assemblée nationale décidée par le Président Macron. Face au retard accumulé, le moment est venu de transposer la Directive. Comme le note Charles Sitzenstuhl, [[35]]url:#_ftn35 , « en faisant le choix d’une simple transposition de la directive à travers ce projet de loi, le gouvernement a fait le choix d’abandonner les propositions formulées par l’Assemblée nationale et le Sénat ». Cette transposition « technique » permettait d’éviter une reprise des débats entre les deux chambres du Parlement. C’était sans compter sur Philippe Gosselin, réélu et devenu vice-président de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République.
8. … à une refonte globale de l’action de groupe – Coup de théâtre parlementaire, par un amendement n° CL 18 en date du 23 novembre 2024[[36]]url:#_ftn36 , Philippe Gosselin insuffle dans le projet de loi un amendement qui rebat les cartes. Il ne s’agit plus de transposer la Directive mais de profiter de cette discussion pour achever les débats sur la réforme avortée en raison de la dissolution. Dans son avis[[37]]url:#_ftn37 , le sénateur Frassa dénonce que « L'Assemblée nationale a toutefois substitué à ces dispositions la version de la proposition de loi relative au régime juridique des actions de groupe qu'elle avait adoptée en première lecture en mars 2023, en réécrivant l'article 14 et en supprimant les articles 15 à 19 du présent projet de loi ». La commission des lois du Sénat considère que « Les difficultés juridiques identifiées par le Sénat lors de l'examen de la proposition de loi précitée demeurent : qu'il s'agisse de l'extension de la qualité pour agir, de l'universalité du champ matériel de l'action de groupe ou de l'introduction d'une sanction civile ». Par mesure de rétorsion, le Sénat annule purement et simplement la reprise de la proposition de loi Gosselin-Vichnievsky et se contente des éléments du projet de loi relatif à la transposition.
9. Un texte de compromis comportant « en même temps » de réelles avancées et des blocages structurels rendant sa lecture et son application difficile. – Pour faire adopter 80 % de sa proposition de loi, comprenant notamment une procédure harmonisée et l’instauration d’une amende civile en présence de faute lucrative, M. Gosselin a dû accepter de renoncer au cœur de son projet : ouvrir l’accès de l’action de groupe à certaines associations non agrées mais ayant démontré sur plusieurs années leur implication dans la défense d’un intérêt collectif. L’intransigeance du sénateur Christophe-André Frassa a conduit à ce compromis bancal : seules les associations agréées peuvent exercer l’action de groupe « réparations » et « cessation des manquements ». Les associations non agréées se voient cantonner, sous certaines conditions, aux actions en cessation. L’agrément devient donc la « voie royale » d’accès à la justice. Il s’agit d’une régression certaine. En effet, l’article 63 de loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle prévoyait « Seules les associations agréées et les associations régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins dont l'objet statutaire comporte la défense d'intérêts auxquels il a été porté atteinte peuvent exercer l'action mentionnée à l'article 62 ». La faculté d’action pour les associations de plus de cinq ans est à présent supprimée pour les actions en réparation. Cette vision aristocratique peut surprendre dans une loi républicaine. Elle entre en contradiction frontale avec l’affirmation selon laquelle l’action de groupe doit faciliter l’accès à la justice. Par ailleurs, l’agrément est délivré par une autorisation administrative qui peut, pour des raisons politiques habillées d’arguments juridiques, bloquer ou non la délivrance de ce passeport, comme cela s’est vu dans le dossier Anticor[[38]]url:#_ftn38 , par exemple.
10. Un travail parlementaire exemplaire ? – Ce texte pourrait être cité en exemple du bon travail réalisé par des parlementaires opiniâtres et courageux. En effet, il a fallu pas moins de trois mandatures pour partir d’un constat, largement partagé par la doctrine et les praticiens, d’une action de groupe inefficace, afin d’arriver à un texte de compromis qui pourrait sinon doper du moins faciliter l’émergence d’un droit de l’action de groupe. Et il y a urgence car la concurrence entre systèmes juridiques européens est patente. De plus, les positions pusillanimes et malthusiennes du Sénat (reprenant celles du Médef ) pourraient être fatales à la Place de Paris (cf. IIIe partie). À présent il reste à découvrir un texte dont la lecture n’est pas évidente[[39]]url:#_ftn39 . Il appartiendra aux praticiens et aux juridictions de le faire vivre avant l’arrivée souhaitable d’une véritable « class action européenne et équitable » que nous appelons de nos vœux[[40]]url:#_ftn40 pour faire face à l’inégalité des armes structurelles entre les consommateurs (voire les citoyens) et les grands acteurs économiques ou étatiques.
* *
*
11. Réforme ou révolution[[41]]url:#_ftn41 ? - Incontestablement, la loi DDADUE contient des avancées pratiques importantes qui pourraient faciliter le développement des actions de groupe. Toutefois, loin de résoudre tous les problèmes pratiques, le nouveau régime de l’action de groupe laisse dans l’ombre des questions importantes qui peuvent devenir autant de nids à complexité procédurale, ce qui pourrait contribuer à faire durer les procédures. Il convient alors de le décortiquer à la lumière des travaux parlementaires et des décrets d’application.
12. Définition de l’action de groupe - L’article 16-I-A alinéa 1 définit l’action de groupe comme l’action exercée par une personne habilitée par la loi « pour le compte de plusieurs personnes physiques ou morales, placées dans une situation similaire, résultant d’un même manquement ou d’un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles commis par une personne agissant dans l’exercice ou à l’occasion de son activité professionnelle, par une personne morale de droit public ou par un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public ». Cette définition purement descriptive ne comporte aucun élément impératif. Autrement dit, l’action de groupe est l’une des formes possibles de l’action collective. D’autres formes sont toujours envisageables, comme l’action collective conjointe, d’autant plus que l’accès à la justice par le vecteur l’action de groupe parait toujours étroit malgré la volonté affichée d’en faciliter le recours. L’action de groupe n’est pas réservée qu’aux personnes physiques. Elle peut également concerner des personnes morales qu’elles soient de droit privé, de droit public. Mais se posera alors la question de la recevabilité d’une telle action faute d’une association préconstituée et agréée.
13. Limitations résultant des dispositions générales contenues dans l’article 16 – Selon Benjamin Pouchoux, la rédaction de l’article 16-I-A qui ne fait pas référence à un fait générateur soulève la question de l’action de groupe indemnitaire dans les hypothèses de « responsabilité sans faute »[[42]]url:#_ftn42 . De même, l’auteur s’interroge sur la rédaction qui semble consacrer l’action de groupe contre un seul auteur. Souvent, les infractions complexes sont l’œuvre de plusieurs co-auteurs. Faut-il viser la holding de tête, qui décide et organise, et laisser de cotés les sociétés-filles qui exécutent les décisions prises ailleurs ? La jurisprudence devra préciser ce point mais, selon nous, si on cherche à rendre effective et efficace l’action de groupe, les juges devront admettre qu’elle est applicable contre plusieurs défendeurs soit qui appartiennent à un même groupe, soit qui agissent de concert dans le cadre d’un cartel, par exemple.
14. Double finalité – Conformément aux articles 8 et 9 de la Directive, l’action vise à obtenir soit la cessation d’un manquement, soit la réparation des préjudices subis du fait de ce manquement. L’article 16-I-A in fine prévoit un cumul possible entre ces deux finalités. L’article 9-1 de la Directive précise les formes diverses que peuvent prendre une mesure de réparation « l’indemnisation, la réparation, le remplacement, la réduction du prix, la résolution du contrat ou le remboursement du prix payé, selon le cas et selon ce que prévoit le droit de l’Union ou le droit national ».
15. Universalité relative - Le caractère universel apparent de la nouvelle action de groupe fait immédiatement l’objet d’une restriction importante en matière d’action de groupe « santé ». En effet, l’article 16-I-B dispose que « lorsqu’elle a pour objet un manquement aux obligations légales ou contractuelles résultant du code de la santé publique, l’action de groupe n’est exercée qu’en raison d’un manquement à ses obligations légales ou contractuelles d’un producteur ou d’un fournisseur de l’un des produits mentionnés au II de l’article L. 5311-1 du même code ou d’un prestataire utilisant l’un de ces produits ». En d’autres termes, il n’est pas possible d’exercer une action de groupe « santé » contre l’État (ou l’une de ses émanations comme l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé) en raison par exemple d’une faute dans l’exercice de leurs prérogatives de police administrative (Cf. Médiator[[43]]url:#_ftn43 ou Lévothyrox[[44]]url:#_ftn44 ). Une action collective conjointe reste donc toujours envisageable pour obtenir la reconnaissance de la responsabilité de l’État. De plus, pour Benjamin Pouchoux, cette rédaction est destinée à protéger les « professionnels de santé » et leurs assureurs[[45]]url:#_ftn45 .
16. Élargissement du domaine d’action en matière sociale - Jusqu’ à présent, l’action de groupe était réservée aux syndicats dans la lutte contre les discriminations (articles L. 1134-6 à L 1134-10 du code du travail) et à la protection des données personnelles (articles 37 et 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 « Informatique & libertés »). L’article 16-I-C ajoute que les syndicats représentatifs peuvent mener une action de groupe « lorsqu’elle tend à la cessation du manquement d’un employeur ou à la réparation de dommages causés par ce manquement à plusieurs personnes placées sous l’autorité de cet employeur ». Dans le fil d’informations du « module RH », les éditions Lefebvre-Dalloz considèrent que « le champ de l’action de groupe est donc très large et nous paraît couvrir l’ensemble de la matière sociale ». Les rédacteurs du Lefebvre-Dalloz proposent deux exemples illustratifs : premier cas « une action en cas de manquement de l’employeur à son obligation de sécurité envers une collectivité de travailleurs, de non-application d’un accord collectif instituant des jours de congés supplémentaires ou encore de défaut de paiement d’heures supplémentaires à tous les salariés d’une entreprise » ; deuxième cas « Selon nous, il résulte de la formulation « plusieurs personnes placées sous l’autorité de l’employeur », identique à celle figurant à l’article L 4111-5 du Code du travail relatif à l’obligation de sécurité de l’employeur, que l’action de groupe émanant d’un syndicat peut viser à réparer les dommages subis par les salariés, mais également les autres travailleurs de l’entreprise (intérimaires, stagiaires, salariés mis à disposition, etc.) ». Cette analyse parait pertinente.
17. Action de groupe en matière de RSE ou de compliance ? - La responsabilité sociale des entreprises (RSE) est définie comme l'intégration volontaire des préoccupations sociales et écologiques à l'activité commerciale des entreprises et dans leurs relations avec leurs parties prenantes[[46]]url:#_ftn46 . C’est en matière de droit social que la RSE a connu ses avancées les plus significatives[[47]]url:#_ftn47 . Pour le professeur François-Guy Trébulle, des « engagements éthiques peuvent devenir des sources de responsabilité », notamment sur le fondement de la publicité trompeuse[[48]]url:#_ftn48 . Plusieurs auteurs[[49]]url:#_ftn49 ont précisé la source juridique à l’origine de cette force contraignante de la RSE : « À partir du moment où l'entreprise prend volontairement des engagements éthiques et les rend publics, elle s'expose à des sanctions dans le cas où elle ne les respecterait pas. Le non-respect par l'entreprise des engagements qu'elle revendique et sur lesquels elle communique aura des répercussions au niveau (…) ».
On cite souvent l’affaire Nike cl Kasky[[50]]url:#_ftn50 , l’entreprise mondialement connue avait été poursuivie pour publicité mensongère à propos d'une campagne de relations publiques sur les conditions de travail chez ses sous-traitants. Assimilant cette campagne à de la publicité, la Cour suprême de Californie a conclu à la recevabilité de l'action intentée contre la société estimant que lorsqu' une entreprise, dans la promotion et la défense de ses ventes et profits, formule des considérations factuelles sur ses propres produits ou son activité, elle est astreinte à une obligation de vérité. Selon nous, l’article 16-I autorise une personne reconnue par la loi à initier une action de groupe au titre de la RSE. Il en irait de même au titre d’une violation des obligations de compliance[[51]]url:#_ftn51 imposées notamment par la loi sur le devoir de vigilance[[52]]url:#_ftn52 et la loi Sapin II[[53]]url:#_ftn53 .
18. Élargissement des préjudices ouvrant droit à une action de groupe - Au détour de l’article 16-I-A alinéa 2 se cache une avancée aussi significative que bienvenue. En effet, on se souvient qu’aux termes de l’article 1143-2 alinéa 3 du code de la santé publique « L'action ne peut porter que sur la réparation des préjudices résultant de dommages corporels subis par des usagers du système de santé ». Autrement dit, l’action de groupe santé ne permettait pas l’indemnisation du préjudice moral et ou du préjudice d’anxiété. La loi nouvelle abroge cette disposition (article 16-XVII-A-7°) et l’article 16-I-A alinéa 2 confirme que l’action de groupe peut viser « la réparation des préjudices, quelle qu’en soit la nature ».
19. Avancée significative – Cette disposition bienvenue pourrait donner un coup de fouet aux actions de groupe, notamment en matière de santé.
20. Ancienne législation - Pour les actions sectorielles, l’article 64 de loi Justice du XXIe siècle et l’article L. 77-10-5 du code de justice administrative prévoyait, à peine d’irrecevabilité, qu’une action de groupe ne pouvait être introduite que quatre mois après une mise en demeure. Cette mise en demeure visait à demander la cessation du manquement ou réparer les préjudices subis.
21. Suppression de la mise en demeure préalable … - La Directive était muette sur cette question, tant est si bien qu’il n’est pas possible de prétendre que sa suppression s’imposait en raison de la transposition. Le rapport d’information Vichnievsky-Gosselin soulignait que cette obligation, loin de favoriser le règlement amiable, était une source de ralentissement de la procédure. La loi DDADUE supprime cette obligation de mise en demeure (article 16-XVII).
22. … sauf en matière de droit du travail – En effet, en cas action de groupe fondée sur un manquement au code du travail, l’article 16-I-F a prévu une procédure particulière passant par le maintien d’une mise en demeure « par tout moyen conférant une date certaine à cette demande » de faire cesser le manquement allégué. Une interprétation stricte de ce texte semble réserver la mise en demeure à la procédure en cessation mais la procédure en réparation semble dispensée de cette obligation.
L’employeur dispose d’un mois pour informer le Comité social et économique, s’il existe, ainsi que les organisations syndicales représentatives. À la demande de l’un ou l’autre des destinataires de l’information, l’employeur « engage une discussion sur les mesures permettant de faire cesser la situation de manquement alléguée ». La loi ne prévoit aucun délai ni aucune sanction.
L’action de groupe peut être engagée « à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la demande tendant à faire cesser le manquement ou à compter de la notification par l’employeur du rejet de la demande ».
23. Reconnaissance de principe du financement par les tiers - Suivant en cela une tendance de fond du droit européen et des autres pays, l’article 16-I-D reconnait la licéité du financement des demandeurs par un tiers. La loi l’encadre strictement « sous réserve que ce financement n’ait ni pour objet ni pour effet l’exercice par ces tiers d’une influence sur l’introduction ou la conduite d’actions de groupe susceptible de porter atteinte à l’intérêt de personnes représentées ». Un décret est prévu pour définir les conditions de publication. Le e Décret n° 2025-734 du 30 juillet 2025 (ci-après le « Décret du 30 juillet 2025 ») n’aborde pas ces questions. L’objectif semble d’assurer la transparence de l’opération et le contrôle par la juridiction saisie de l’indépendance des demandeurs.
24. Absence de levée des incertitudes relatives au monopole bancaire – On peut regretter que le législateur n’ait pas profiter de l’occasion pour mettre un terme à une incertitude majeure qui gêne le développement du legal finance en France[[54]]url:#_ftn54 . Dans son rapport[[55]]url:#_ftn55 , le Club des juristes avait parfaitement synthétisé les enjeux : « L’activité de financement de procès peut-elle être qualifiée d’opération de crédit au sens de l’article L. 313-1 du code monétaire et financier ? L’enjeu est de taille car lorsque les opérations de crédit sont exercées à titre habituel, elles entrent dans le champ du monopole bancaire dont la violation est pénalement sanctionnée. Pour les raisons ci-dessus développées, et compte tenu du principe d’interprétation stricte des textes pénaux, il peut être considéré que le financement de procès par un tiers ne constitue pas une opération de crédit au sens du code Monétaire et Financier et n’entre donc pas dans le champ du monopole bancaire. (…) Cependant, on ne peut pas totalement exclure que s’agissant d’une pratique encore inédite en France ne bénéficiant d’aucun précédent et d’analyses doctrinales peu nombreuses, les éléments de différenciation entre contrat de crédit et financement de procès ne soient pas jugés suffisamment forts pour exclure de manière absolument certaine l’opération envisagée du champ des contrats de crédit et du monopole bancaire. Dès lors, pour renforcer la sécurité juridique de notre droit, il serait souhaitable de plaider en faveur d’une intervention du législateur excluant expressément du champ du monopole bancaire les sociétés de financement de procès. Une telle intervention pourrait prendre la forme d’un ajout d’alinéa à l’article L. 511-6 du code Monétaire et Financier. » Il est regrettable que cette proposition simple, efficace n’ait pas été ajoutée dans le cadre de la loi Ddadue. Cela aurait renforcé la position de la place de Paris en offrant aux acteurs une sécurité juridique qui pourrait constituer un atout supplémentaire (cf. IIIème partie).
25. L’association agréée doit être indépendante - L’article 16-I-C-1-4°) prévoit que pour apprécier l’indépendance d’une association agréée, cette dernière doit adopter « à cette fin des procédures écrites de prévention et de gestion des conflits d’intérêts ». La loi définit l’indépendance par l’absence d’influence des personnes autres que celles dont elle défend les intérêts. La loi vise expressément les personnes « ayant un intérêt économique dans l’introduction d’une action de groupe ». Autrement dit, si un groupe financier pensait pouvoir utiliser une association agréée ou en prendre le contrôle, cela entrainerait des conséquences majeures : de la perte de l’agrément à l’irrecevabilité de l’action de groupe.
26. Procédure interne de prévention des conflits d’intérêts - Afin de renforcer l’indépendance du demandeur à l’action en réparation, l’article 16-I-E alinéa 1 prévoit que le demandeur « veille, en tout état de la procédure, à ne pas se placer en situation de conflit d’intérêts et à préserver l’exercice de l’action de groupe qu’il engage de l’influence d’un tiers à l’instance susceptible de porter atteinte à l’intérêt des personnes représentées ». Cette mise en place d’une véritable compliance est loin d’être anodine. Elle va générer des coûts certains (cartographie des risques, création d’un poste de compliance officer, rédaction de code de bonne conduite, de charte et autres dispositifs d’audit) pour les associations agréées ce qui viendra encore restreindre le nombre d’acteurs pouvant initier des actions de groupe en réparations. C’est à la lumière de ces détails que l’on peut douter de la volonté du législateur d’assurer l’essor des actions de groupe en France.
27. Preuve impossible et renversement de la charge de la preuve - Le défendeur à l’action se voit offrir un moyen de défense particulièrement efficace : il peut contester l’indépendance du demandeur. Dans ce cas, « le juge peut enjoindre à ce dernier de produire les pièces justifiant de l’absence de conflit d’intérêts ». Cette formulation peut paraitre curieuse car elle impose une preuve négative qui est une probatio diabolica (« preuve du diable ») à manier avec précaution. Elle offre un boulevard pour le défendeur à l’action qui pourra faire état de simples suspicions[[56]]url:#_ftn56 et obliger le demandeur à rapporter une preuve difficile sinon impossible.
28. Une sanction efficace mais disproportionnée ? Si le juge constate que le demandeur est placé dans une situation de conflits d’intérêts, la sanction est d’autant plus sévère qu’elle ne semble pas prévoir de régularisation possible. En effet, le juge « déclare l’action irrecevable et refuse l’homologation de tout accord entre les parties » (article 16-I-E alinéa 2 in fine). L’article 849-12 du code de procédure civile (dans sa rédaction issue du Décret du 30 juillet 2025) dispose que « La fin de non-recevoir tirée de la situation de conflit d’intérêts dans laquelle le demandeur se trouve à l’égard des personnes représentées peut être relevée d’office par le juge. ».
29. Absence de sanction pour la procédure en cessation - Une interprétation a contrario de cet article permet d’affirmer qu’il ne s’applique pas à la procédure en cessation en manquement.
30. Innovation substantielle - Dans son avis sur la proposition de la loi Gosselin-Vichnievsky [[57]]url:#_ftn57 , le Conseil d’État considère que « les dispositions sur l’action de groupe constituent des règles de procédure spéciales qui s’appliquent à la responsabilité sans modifier en rien les règles de fond qui régissent cette matière (…) Le Conseil d’État estime en conséquence que le régime de l’action de groupe présente le caractère d’une loi de procédure qui n’a pas vocation à prendre place dans le code civil. » (§ 8). Il avait pris la peine de réserver l’hypothèse de la sanction civile qui constituait une « innovation très substantielle » de la responsabilité civile. Dans la rédaction de la proposition de loi, le Conseil avait approuvé la création d’une telle amende tout en émettant des réserves. D’abord, il considère que cette sanction présente une vertu « dissuasive de certains comportements professionnels fautifs ». Reprenant l’argument tiré du rapport d’information Gosselin-Vichnievsky, le Conseil d’État considère qu’« en cas de succès de l’action de groupe, le montant de la condamnation de l’entreprise pourra souvent être inférieur au profit retiré par l’entreprise du fait de la faible proportion des victimes lésées participant à l’action » (§ 17). Il en conclut que « l’introduction de cette sanction civile, qui ne s’assimile pas à des dommages et intérêts punitifs dès lors qu’elle n’est pas versée à la victime ». De ce point de vue, l’amende civile n’entre pas en contradiction avec les objectifs de la Directive, bien au contraire, elle vise à renforcer l’efficacité du dispositif.
Mais, en insérant dans le code civil un article 1254 et en créant un chapitre V intitulé « sanction civile en cas de faute dolosive ayant causé des dommages sériels », le législateur n’a pas entendu créer une différence de traitement entre les victimes ayant fait le choix de l’action de groupe et les autres formes d’actions collectives. Comme le note le Conseil d’État « eu égard à son objet, un tel mécanisme n’est pas inhérent à l’action de groupe et pourrait tout aussi bien s’appliquer dans le cadre d’une procédure d’action collective, d’action conjointe, voire d’action individuelle ». Ce qui était vrai pour la proposition l’est tout aussi avec la loi DDADUE. Le fait que l’amende civile n’abonde plus le Trésor public mais un « fonds consacré au financement des actions de groupe » n’est pas suffisant pour prétendre que ce texte est cantonné aux seules actions de groupe. En effet, la vertu d’une telle amende est indépendante de son bénéficiaire. L’amende civile procède l’effet régulateur d’une action collective (quelle qu’en soit la forme de groupe, conjointe, nationale ou transfrontière)[[58]]url:#_ftn58 . Dans son avis, le Conseil d’État émettait plusieurs recommandations qui ont inspiré la loi DDADUE et qui lui ont permis de passer le filtre constitutionnel[[59]]url:#_ftn59 .
31. Définition de la faute lucrative - L’article 16-XI prévoit de sanctionner la faute lucrative commise par le défendeur à l’action de groupe en créant un chapitre V « Sanction civile en cas de faute dolosive ayant causé des dommages sériels » dans le code civil. Cette disposition a été très sévèrement critiquée par le Medef et le LEEM (Les entreprises du médicament) sans que cela n’ait impacté la décision du Conseil constitutionnel (cf. IIIème Partie).
32. Une course d’obstacles pour obtenir l’amende civile – Le nouvel article 1254 du code civile prévoit plusieurs filtres rendant son application résiduelle
· D’abord, le demandeur à l’action de groupe ne peut pas solliciter une telle amende civile qui est réservée au « ministère public, devant les juridictions de l’ordre judiciaire, ou [au] Gouvernement, devant les juridictions de l’ordre administratif ».
· Enfin, le juge doit motiver « spécialement » sa décision. À cet égard, l’alinéa 2 de l’article 1254 prévoit deux conditions cumulatives. Première condition : « L’auteur du dommage a délibérément commis une faute en vue d’obtenir un gain ou une économie indu ». Deuxième condition « Le manquement constaté a causé un ou plusieurs dommages à plusieurs personnes physiques ou morales placées dans une situation similaire. »
La formule introductive (« Lorsqu'une personne est reconnue responsable d'un manquement aux obligations légales ou contractuelles afférentes à son activité professionnelle ») interroge tant elle parait extensive. De plus, elle parait déconnectée de l’action de groupe en étant placé dans le code civil. La jurisprudence devra préciser s’il s’agit d’une amende civile réservée aux seules actions de groupe ou si elle peut être utilisé dans d’autres procédures, les actions collective conjointes par exemples.
33. Détermination de l’amende civile, proportionnalité, et cumul des sanctions financières - L’alinéa 3 guide le juge dans la détermination du montant de la sanction qui doit être « proportionné à la gravité de la faute commise et au profit que l’auteur de la faute en a retiré ». La loi prévoit également un plafond si l’auteur est une personne physique, « ce montant ne peut être supérieur au double du profit réalisé » mais si l’auteur est une personne morale, « ce montant ne peut être supérieur au quintuple du montant du profit réalisé ». Ultime précaution, en cas de cumul avec une amende administrative ou pénale infligée en raison des mêmes faits à l’auteur du manquement, « le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé ».
34. L’amende civile n’est pas assurable - L’article 1254 in fine précise que le risque d’une condamnation à la sanction civile « n’est pas assurable ».
35. Création d’un « fonds consacré au financement des actions de groupe » - Le produit de cette amende civile est « affecté à un fonds consacré au financement des actions de groupe. ». Cette disposition appelle deux observations :
· Il n’est pas possible pour un demandeur (association, syndicat, entité qualifiée) que le produit de cette amende civile leur revienne ou vienne enrichir les victimes comme cela est le cas aux USA avec les punitives damages[[60]]url:#_ftn60 .
· Le fonds consacré au financement des actions collectives n’existe pas. Il est apparu, au grand dam de la Chancellerie, au détour d’un amendement adopté lors de la Commission mixte paritaire. Sa composition, son fonctionnement, la répartition des sommes potentielles devra faire l’objet d’un décret d’application qui risque de se faire attendre. En tout cas, le Décret du 30 juillet 2025 n’aborde pas ces questions. De là, à penser que cette disposition est purement déclaratoire (voire déclamatoire) à défaut d’être performatrice, il n’y a qu’un pas.
36. Une réflexion sur le bénéficiaire de l’amende civile s’impose - On pourrait imaginer que si ce fonds voit le jour et s’il est suffisamment doté, il puisse aider les associations agréées à respecter leurs obligations de compliance. La rédaction de la loi semble empêcher qu’il devienne un moyen accessoire de financer l’aide juridictionnelle des procédures individuelles. Si on comprend bien la défiance du législateur à permettre un enrichissement des victimes en ce partageant l’amende civile, on aurait pu proposer la création d’un mécanisme « cy-près » pour renforcer le caractère régulateur de cette disposition[[61]]url:#_ftn61 .
37. Amende civile propre au droit de la consommation - L’article 16-XII prévoit une disposition d’harmonisation du code de la consommation. Ainsi, le troisième alinéa de l’article L. 132-1 A devient « L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, agissant sur le fondement de l'article L. 524-2 ou intervenant à l'instance, les associations de défense des consommateurs, agissant sur le fondement des articles L. 621-7, L. 621-9, et L. 622-1 du présent code et des I à XI de l'article 16 de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes, le ministère public ou le consommateur peuvent demander à la juridiction saisie de prononcer une amende civile dont le montant ne peut excéder 300 000 euros ». Les deux alinéas suivants de ce texte demeurent inchangés.
38. Identification de deux amendes civiles cumulables - Ainsi, il semble exister deux amendes civiles :
· La première de droit commun résulte du nouvel article 1254 du code civil et tend à sanctionner la « faute dolosive ayant causé des dommages sériels », autrement dit une faute lucrative ;
· La seconde issue du droit spécial de la consommation vise à sanctionner :
o Soit une « infraction de grande ampleur ou de grande ampleur à l'échelle de l'Union européenne, en application de l'article 21 du règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs, à l'encontre d'un professionnel qui a recours, de manière continue, à une pratique commerciale reconnue déloyale » ;
o Soit une « pratique commerciale reconnue déloyale, au sens de l'article L. 121-1, autre que l'une de celles mentionnées au quatrième alinéa de cet article, par une décision du Conseil d'État ou un avis rendu en application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, ou un arrêt de la Cour de cassation ou un avis rendu en application de l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire ».
39. De l’observatoire au registre – Jusqu’à présent, il n’existait qu’un observatoire des actions de groupe[[62]]url:#_ftn62 . Créé à l’initiative du professeur Maria-José Azar-Baud (Université Paris XI-Saclay), cet observatoire universitaire, pluridisciplinaire et comparatiste permet de suivre l’actualité d’une matière riche et en perpétuelle évolution. Devant l’échec des actions de groupe jusqu’à présent, l’observation a été étendue à toutes les formes d’actions collectives. « L’idée d’un Observatoire des Actions de Groupe et d’autres Actions Collectives part de trois constats : l’adoption des actions collectives est un phénomène global , la recherche sur les actions collectives est pluridisciplinaire et il n’existe pas à ce jour de Registre d’actions de groupe en France ». L’article 16-IV palie la lacune puisqu’il prévoit qu’un « registre public des actions de groupe en cours devant l’ensemble des juridictions est tenu et mis à la disposition du public par le ministre de la justice ».
40. Un registre informatif - L’article 14 du Décret du 30 juillet 2025 précise les modalités de fonctionnement de ce registre. Ce registre est strictement limité aux actions de groupe « engagées sur le fondement de l’article 16 de la loi du 30 avril 2025 ». Il n’est pas prévu un site dédié, c’est le site internet du ministère de la Justice qui accueillera le registre.
L’article 14-I précise les informations devant apparaitre : « 1°) L’identité des parties ; 2°) La nature du manquement invoqué ; 3°) La nature des dommages allégués ; 4°) Les éléments permettant d’apprécier la similarité des situations des personnes en faveur desquelles l’action est présentée ; 5°) La juridiction saisie ; 6°) Le cas échéant, le sens des décisions rendues ».
L’article 14-II du Décret prévoit les règles d’effacement de ces informations, notamment rejet de la demande, fin de non-recevoir ou « tout autre incident mettant fin à l’instance est passée en force de chose jugée ».
L’article 14-III renvoie à un arrêté du Garde des Sceaux pour déterminer les conditions d’alimentation par les greffes et de mise à jour du registre ainsi que ses modalités de gestion au sein du ministère de la Justice.
41. Application différentielle de la loi suivant les sujets traités - L’article 16-XVII prévoit quatre règles relatives à l’application de la loi dans le temps :
· Les personnes remplissant les conditions pour exercer une action de groupe à la date de l’entrée en vigueur du présent article conservent cette faculté pendant un délai de deux ans à compter de 1er mai 2025 (article 16-XVII-D). Ce maintien de l’agrément pourra permettre aux associations concernées de se mettre en conformité avec le nouveau régime de l’agrément.
· Les dispositions abrogées par le A de l’article XVII, c’est-à-dire les différents régimes applicables avant la loi du 30 avril 2025 (consommation, environnement, santé, discrimination, etc.) demeurent applicables aux actions introduites avant la publication de la présente loi (article 16-XVII-E).
· À l’exception de l’article 16- XI (amende civile), la loi est applicable aux seules actions intentées après la publication de la présente loi.
· Enfin, l’article 16-XI, instaurant une amende civile pour sanctionner une faute dolosive ayant causé des dommages sériels, est applicable aux seules actions dont le fait générateur de la responsabilité du défendeur est postérieur à la publication de la présente loi.
42. Précisions sur l’application des règles de procédure dans le temps – Le Décret du 30 juillet 2025 vient compléter le détail des règles de procédure applicables[[63]]url:#_ftn63 . Son article 16 précise que « Le présent décret est applicable aux instances introduites à compter de l’entrée en vigueur de la loi du 30 avril 2025 susvisée. Les actions de groupe introduites avant l’entrée en vigueur de cette loi demeurent régies par les dispositions applicables du code de procédure civile et du code de justice administrative, dans leur rédaction antérieure au présent décret ».
43. Précisions sur l’application de la Loi DDADUE Outre-mer - L’article 16-XIV prévoit que, dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution[[64]]url:#_ftn64 , dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna, « les associations de consommateurs représentatives au niveau local » peuvent également agir dans les mêmes conditions que les associations agréées. De même, les I à IX sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, ce qui exclut l’amende civile créée par l’article 16-XI. Enfin, les références à la Directive (UE) 2020/1828 sont remplacées par des références aux règles applicables en métropole ayant le même objet.
44. Summa divisio - Même s’il existe des règles communes, la summa divisio entre les actions de groupe réside entre les actions de groupe « nationales » régies par les articles 16-I à 16-IX et les actions transfrontières régies par l’article 16-X. Par ailleurs, la Loi DDADUE et les décrets d’application du 16 et 30 juillet 2025 détaillent les procédures suivant que la juridiction saisie appartient à l’ordre judiciaire ou l’ordre administratif.
a) Le monopole des associations agréées est maintenu voire renforcé
(i) De l’importance de l’agrément
21. Vives oppositions entre l’Assemblée nationale et le Sénat - Lors des débats sur la proposition de loi Gosselin-Vichnievsky, la question de la qualité à agir avait concentré une grande partie des réserves voire des oppositions franches du Sénat. Les échos de cette opposition se sont retrouvés jusqu’à la Commission mixte paritaire qui a finalement adopté le texte en raison de l’esprit de compromis de M. Philippe Gosselin (cf. Première Partie)
45. L’agrément constitue un passeport de plein exercice pour initier une action de groupe réparations - L’agrément constitue l’une des questions centrales de l’action de groupe. M. Christophe-André Frassa a d’ores et déjà indiqué que les futurs défenseurs, plutôt des groupes multinationaux pouvant avoir recours à des cabinets d’avocats internationaux onéreux, allaient concentrer leur défense sur l’existence et la consistance de cet agrément. Il est à craindre que se développe un contentieux secondaire, devant les juridictions administratives, dont l’objectif dilatoire parait évident. Ainsi, l’agrément se retourne contre les associations qui se voient placées sur la sellette et devront justifier des conditions et de la régularité de la procédure d’obtention. Cette situation est loin d’être théorique. En effet, dans un dossier de santé publique, une association de victimes de dispositifs médicaux jugés trop belliqueuse contre l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et le producteur s’est vu retirer son agrément au prétexte qu’elle recevait trop de financement (25 %) qui n’étaient ni des subventions ni des dons de ses membres. Ce contentieux secondaire pourrait devenir central et entraîner des allongements considérables de la durée des procédures permettant aux défendeurs de reporter les discussions sur l’étendue de leurs responsabilités[[65]]url:#_ftn65 .
(ii) Obtention de l’agrément
46. Absence de régime unitaire et d’autorité unique de délivrance : un droit en évolution ? – Pour le moment, il n’existe pas une autorité unique de délivrance des agréments, notamment pour tenir compte des impératifs sectoriels de chaque association. Mais avec la loi DDADUE, on assiste à un début d’uniformisation des conditions de délivrance et de contrôle de celles-ci. Compte tenu de l’importance de l’agrément, on peut anticiper que les questions pratiques soulevées ne manqueront pas d’être soumises aux juridictions.
47. Conditions d’obtention de l’agrément – Clairement inspiré par la Directive, l’article 16-I-C-1 détaille les quatre conditions requises pour l’obtention d’un agrément.
· Première condition : Être une association déclarée à but non lucratif[[66]]url:#_ftn66 (article 16-I-C-1) qui, à la date de la demande d’agrément, « de l’exercice d’une activité effective et publique de douze mois consécutifs en vue de la défense d’intérêts auxquels il a été porté atteinte » (article 16-I-C-1-1°) et dont son objet statutaire comporte la défense d’intérêts auxquels il a été porté atteinte (article 16-I-C-1-2°),
· Deuxième condition : à la date de demande d’agrément, l’association ne doit pas être soumise à une des procédures collectives prévues par le Livre VI du Code de commerce (article 16-I-C-1-3°)
· Troisième condition : l’association doit être « indépendante » Sur ce point et l’absence de conflits d’intérêts, cf. n ° supra 24 et s.
· Quatrième condition : L’association doit être transparente « sur ses activités, ses sources principales de son financement et son organisation ». (article 16-I-C-1-5°)
48. Délivrance et retrait – La loi est parfois tautologique : « L’agrément peut être octroyé par l’autorité administrative chargée de sa délivrance » (sic) Mais la loi se garde bien d’identifier cette autorité. Il semblerait que l’agrément soit délivré par une autorité unique et soit distinct d’autres agréments délivrés par l’État dans certaines matières spécifiques. Le Décret du 30 juillet 2025 n’apporte aucune précision en la matière. La procédure d’agrément, les voies de recours ne sont pas précisées par la loi et feront l’objet d’un décret d’application. « L’agrément peut être retiré par l’autorité administrative chargée de sa délivrance lorsqu’elle constate que l’une des conditions prévues n’est plus remplie » (article 16-I-C-1 alinéa 2).[[67]]url:#_ftn67
49. Durée déterminée de l’agrément : 5 ans – L’article 25-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations dispose que « Toute association qui s'est vu délivrer un agrément est réputée remplir ces conditions pendant une durée de cinq ans dans le cadre de toute procédure d'agrément prévue par la législation ».
50. Publicité - La liste des associations agréées sera mise à la disposition du public dans des conditions fixées par décret (simple). Même si les conditions d’obtention de l’agrément sont proches, on peut être une association agréée sans pour autant prétendre au statut d’entité qualifiée. Les associations veilleront à solliciter cette double qualité si elle souhaite initier des actions transfrontières.
(iii) Cas particulier des agissements illicites
51. Manquement par un professionnel à ses obligations légales ou contractuelles vs agissements illicites – Dans son ouvrage, le professeur Jérôme Julien[[68]]url:#_ftn68 rappelle que « Si toute association ayant la personnalité morale peut agir en justice en invoquant un intérêt propre à agir – comme toute personne – seules celles qui ont reçu un agrément peuvent agir en invoquant l’intérêt des consommateurs. Ce n’est qu’en 1973, par la loi Royer. [Ainsi] l’article L. 621-1. précise que l’association agréée peut « exercer les droits reconnus à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif des consommateurs ». Deux conditions sont exigées pour qu’une telle action puisse prospérer : l’existence d’une infraction pénale, et une atteinte à l’intérêt collectif des consommateurs. L’article L. 621-7 du Code de la consommation vise l’action en cessation d’agissements illicites. Il s’agit d’une action qui permet à une association de demander en justice, devant la juridiction civile, la fin ou l’interdiction de tout agissement illicite (…) » A l’origine, l’article visait uniquement l’action en suppression de clauses abusives. Par extension de la loi n° 88-14 du 5 janvier 1988 relative aux actions en justice des associations agréées de consommateurs et à l'information des consommateurs, cet article a été généralisé à la cessation d’agissements illicites, comme les pratiques déloyales. Avec l’article 16-XII-2°), les associations mentionnées à l’article L. 621-1 du code de la consommation[[69]]url:#_ftn69 « peuvent agir devant la juridiction civile pour faire cesser ou interdire tout agissement illicite portant directement ou indirectement atteinte à l’intérêt collectif des consommateurs ». La différence avec l’action de groupe ? Cette dernière vise un manquement légal ou contractuel commis par un professionnel portant atteinte à « plusieurs personnes physiques ou morales » (article 16-I-A alinéa 1). Sans être des comportements pénalement sanctionnés[[70]]url:#_ftn70 , les agissements illicites subsument les manquements à des obligations légales ou contractuelles. D’abord, parce qu’une telle action peut être purement préventive. Elle aura un effet erga omnes. Les associations agréées au titre des agissements illicites n’ont pas besoin de justifier qu’elles agissent « pour le compte de plusieurs physiques ou morales placées dans une situation similaire ». D’après le « Vocabulaire juridique Cornu », un manquement est le fait de faillir à un devoir lorsqu’un agissement est plutôt un « comportement, une manœuvre ». On comprend bien que l’agissement est plus large et plus polymorphe que le manquement.
b) Les organisations représentatives dans le domaine social
52. Organisations syndicales de salariés et fonctionnaires - L’article 16-I-C-1 in fine dispose que l’action de groupe peut être exercée par les « organisations syndicales représentatives »[[71]]url:#_ftn71 et par les organisations syndicales représentatives des magistrats de l’ordre judiciaire[[72]]url:#_ftn72 . Ces syndicats représentatifs sont dispensés de la procédure d’agrément comme les associations. Ils peuvent agir dans l’un des trois domaines suivants : la lutte contre les discriminations ; la protection des données personnelles ; ou la cessation du manquement d’un employeur ou la réparation de dommages causés par ce manquement à plusieurs personnes placées sous l’autorité de cet employeur.
53. Perte du monopole syndical – La rédaction de l’article 16-I-C-1 conduit à considérer que l’action de groupe en réparation et/ou en cessation de manquement dans les trois domaines sus rappelées est également ouverte, en principal ou conjointement, aux associations agréées. L’action en cessation d’un manquement de l’employeur est également ouverte aux associations non-agréées. Comme le remarquent les rédacteurs du Lefebvre-Dalloz « le monopole des syndicats sur l’action de groupe en cas de discrimination au long de la carrière est donc supprimé ».
54. Cumul de l’action de groupe avec d’autres formes d’actions en justice préexistantes et maintenues – Les syndicats disposent d’un choix procédural entre trois actions : l’action en substitution[[73]]url:#_ftn73 , l’action en défense des intérêts collectifs de la profession[[74]]url:#_ftn74 et l’action de groupe au domaine élargi. L’avantage de l’action de groupe par rapport à cette dernière réside dans la recevabilité des syndicats à défendre les intérêts individuels des salariés.
c) Cas particulier des exploitants agricoles et des pêcheurs
55. Organisations professionnelles d’exploitants - Pour exercer une action de groupe en cessation du manquement ou en réparation de dommages causés par ce manquement à plusieurs de leurs adhérents, les « organisations syndicales à vocation générale d’exploitants agricoles et les organisations des pêcheurs et des professions de la mer représentatives » doivent respecter les conditions fixées par l’Article 16-I-C-1 pour permettre aux associations d’obtenir l’agrément. Il semble que l’agrément résultant de l’arrêté du 19 juillet 2019 ne soit pas suffisant[[75]]url:#_ftn75 .
56. Interprétation a contrario ? – Ce texte semble créer une différence de traitement significative entre les organisations professionnelles d’exploitants agricoles et les organisations professionnelles d’autres activité économique. Ainsi, les organisations professionnelles agricoles peuvent-elles initier une action de groupe en réparation en raison d’un comportement anticoncurrentiel (entente ou abus de position dominante de la grande distribution) mais les syndicats des entreprises de la grande distribution ne pourraient pas exercer une action de groupe en cas d’entente entre fournisseurs (de sodas par exemple). Cela signifie également que ni le Medef ni le CEPME ne pourraient initier une action de groupe contre des concurrents étrangers peu respectueux de la législation européenne ou française. Pour le professeur Rafaël Ramaro[[76]]url:#_ftn76 , « le régime de l’action « concurrence » est à peu près maintenu en l’état. Le monopole des associations de consommateurs est préservé » ce qui peut, à l’évidence poser des questions, l’agenda d’une association de consommateurs ne coïncide pas avec celui d’une organisation professionnelle sectorielle ou non.
57. Solutions bancales - Deux solutions sont possibles pour les organisations patronales hors activité agricole : soit créer une association dédiée et en demander l’agrément ; soit limiter l’action de groupe à des mesures de cessation d’un manquement. Selon nous, il serait plus simple – et plus juste ! – d’étendre à toutes les organisation professionnelles la possibilité d’initier une action de groupe en matière de cessation comme en réparation.
d) Intervention des association non agréées en matière de cessation
58. La première bataille de la qualité à agir - Dans leur rapport de 2020[[77]]url:#_ftn77 , Philippe Gosselin et Laurence Vichnievsky avaient considéré que « les conditions requises pour avoir la qualité à agir sont trop restrictives » et aux termes de leurs auditions, ils avaient présenté une proposition n° 2 ainsi rédigée « donner la qualité à agir : (i) aux associations dont l’objet social inclut celui du litige et ayant au moins deux ans d’existence ; et (ii) aux associations ad hoc composées d’au moins cinquante personnes physiques ou d’au moins dix entreprises constituées sous la forme de personnes morales et ayant au moins deux ans d’existence ». Cette proposition fut logiquement reprise et étendue dans leur proposition de loi.[[78]]url:#_ftn78 Le texte adopté par l’Assemblée nationale à l’unanimité prévoyait que « L’action de groupe peut être exercée par « 1°) les associations agréées ; 2°) les associations régulièrement déclarées depuis deux ans au moins dont l’objet statutaire comporte la défense d’intérêts auxquels il a été porté atteinte ; 3 ) les associations composées d’au moins cinquante personnes physiques ; 4°) les associations composées d’au moins dix entreprises constituées sous la forme de personnes morales ayant au moins deux ans d’existence ; 5°) les associations composées d’au moins cinq collectivités territoriales ». L’objectif clairement affiché est de dépasser les 15 associations agréées. Ce texte devait affronter les huées de la Commission des lois du Sénat[[79]]url:#_ftn79 . Le texte adopté par le Sénat supprime toutes les associations non agréées et vient préciser les conditions de délivrance de l’agrément en renforçant la lutte contre les conflits d’intérêts et la nécessaire informations du public sur les buts et les moyens de l’association. Cette mouture sénatoriale ne fut jamais discutée à l’Assemblée nationale en raison de la dissolution de juin 2024.
59. La deuxième bataille de la qualité à agir – Lorsque Philippe Gosselin réintroduit par amendement sa proposition de loi dans le projet de loi, il repart de la version adoptée à l’unanimité par l’Assemblée nationale le 8 mars 2023. Dans son avis, la Commission des lois du Sénat fait connaître son vif mécontentement à mots de moins en moins feutrés : « Cette reprise sans modification majeure de la mouture de la proposition de loi adoptée en mars 2023 par l’Assemblée nationale a pour effet que l’article 14 prévoit désormais un champ d’application universel de l’action de groupe et des modalités d’octroi de l’intérêt à agir excessivement ouvertes. ». Le Sénat refuse de céder et supprime les insertions de l’Assemblée nationale relatives à la qualité pour agir.
60. Le compromis devant la Commission mixte paritaire sur les actions en cessation de manquement pour les associations non agréées – Philippe Gosselin et Christophe-André Frassa se rapprochent et trouvent un compromis. L’essentiel du projet de loi dopé à la proposition Gosselin-Vichnievsky sera conservé à condition que certaines propositions du Sénat sur les conditions d’obtention de l’agrément soient intégrées. Mais, il reste un écueil majeur : « Philippe Gosselin propose d’attribuer la qualité pour agir à certaines associations capables de prouver trois ans d’ancienneté [au lieu de deux ans dans la proposition initiale], que l’action de groupe concerne la cessation d’un manquement ou la réparation d’un préjudice ».[[80]]url:#_ftn80 Christophe-André Frassa s’oppose frontalement à cette solution car « une telle ouverture risquerait de vider le système de l’agrément de son efficacité. L’agrément constitue pour les personnes lésées une assurance : il accélère la procédure, en évitant des contentieux internes liés à un éventuel conflit d’intérêts du demandeur ; et il garantit que l’association est en mesure de mener à terme cette procédure pluriannuelle, complexe, qui peut avoir des conséquences financières considérables ». Pour débloquer la situation, il est alors proposé de reconnaître associations à but non lucratif régulièrement déclarées depuis deux ans au moins qui justifient de l’exercice d’une activité effective et publique de vingt-quatre mois consécutifs et dont l’objet statutaire comporte la défense d’intérêts auxquels il a été porté atteinte, pour les seules actions en cessation de manquement pour les. C’est le texte finalement adopté à l’article 16-I-C-1 alinéa 4.
e) Les entités qualifiées au sens de la Directive 2020/1828
61. Confusion entre action de groupe et action représentative ? (non) - L’article 16-I-C-3. dispose que « l’action de groupe peut également être exercée par les entités qualifiées ». Pour ces dernières, la loi renvoie à leur inscription sur la liste publiée au Journal officiel de l’Union européenne en application de l’article 5 de la Directive. On pourrait croire à première lecture que les entités qualifiées françaises ou appartenant à un autre État membre, peuvent participer à n’importe quelle « action de groupe » (de droit de la consommation comme santé, environnement ou social). La position de cette disposition dans l’article 16-I-C relatif aux actions de groupe « nationales » milite en ce sens. En effet, les actions « transfrontières » sont régies par les dispositions spéciales de l’article 16-X. Toutefois, l’article 16-I-C prend la peine de préciser que les entités qualifiées interviennent « en vue de la cessation ou de l’interdiction des agissements illicites au regard des dispositions du droit de l’Union européenne mentionnées à l’annexe I » de la Directive. Mais, l’article 16-I-C vient immédiatement préciser que « Ces entités qualifiées peuvent également exercer devant le juge judiciaire l’action tendant à la réparation des préjudices subis, dans les conditions énoncées au III du présent article ». Or cet article ne vise que les actions de groupe « nationales ». Alors, la solution pourrait venir du fait que pour être entité qualifiée, et être inscrite à ce titre sur la liste tenue par la Commission européenne, il faut défendre l’un des droits de l’Union visés par l’Annexe 1. Imaginons le cas d’école suivant : une association de consommateurs italiennes est inscrite à ce titre sur la liste européenne des entités. Son objet social prévoit à titre accessoire la « défense de l’environnement ». En raison de la rédaction actuelle, cette entité qualifiée a-t-elle le pouvoir d’initier une action de groupe dans l’environnement sans avoir besoin d’être agrée par les autorités françaises ? Cela peut s’entendre car une pollution, contrairement aux affirmations du CEA, ne respecte aucune frontière géographique voire juridique.
f) Le ministère public
62. Le ministère public demandeur d’une action de groupe ? - L’article 16-I-C-4., prévoit que « le ministère public peut exercer, en qualité de partie principale, l’action de groupe en cessation du manquement. Il peut également intervenir, en qualité de partie jointe, dans toute action de groupe ». Par exception, l’’article 16-XII prévoit qu’en matière d’action de groupe devant les juridictions administratives (articles L. 77-10-1 et s. du code de justice administrative), le ministère public ne peut pas exercer, en qualité de partie principale, l’action de groupe en cessation du manquement. Cette disposition évitera la schizophrénie de l’État qui verrait le ministère public demander à la juridiction administrative d’ordonner à l’administration de cesser un manquement.
g) Possibilité d’actions conjointes ou d’intervention volontaire
63. L’union fait-elle la force ? - Dans une rédaction peu lisible, l’article 16-C-5 prévoit que les associations agrées, les syndicats et/ou les entités qualifiées « peuvent exercer une action de groupe en application du A du présent I peuvent exercer cette action conjointement ou intervenir volontairement à une instance en cours ». Cette précision tend à confirmer qu’une entité qualifiée peut exercer une action de groupe en dehors du cadre instauré par l’Annexe 1 de la Directive, pour peu que son objet statutaire le lui permette. Mais cette précision ouvre plus de questions qu’elle n’apporte de réponse : que se passe-t-il en cas de désaccord entre deux demandeurs également recevables (l’un veut poursuivre la procédure, l’autre est prêt à accepter un règlement transactionnel) ? Existe-t-il une hiérarchie entre eux ? Si oui sur quelle base : le demandeur initial doit-il avoir plus de droit que les intervenants ? Doit-on tenir de la puissance relative ou de la représentativité de l’association ? Comme le juge va-t-il partager les frais de justice ? Autant de questions pour lesquelles qu’il appartiendra au décret d’application de proposer des solutions pratiques. En l’état, le Décret du 30 juillet 2025 ne répond à ces interrogations pour la procédure judiciaire. Tout au plus, la nouvelle rédaction de l’article R 77-10-3 du code de justice administrative prévoit-elle les règles de résolution du concours entre une action individuelle et une action de groupe.
h) Cas particulier prévu par la loi Informatique & Libertés
64. Extension du droit d’agir - L’article 16-XV modifie l’article 38 de la loi Informatique & Libertés en précisant que tout personne peut mandater (i) une association régulièrement déclarée depuis cinq ans au moins ayant dans son objet statutaire la protection de la vie privée ou la protection des données à caractère personnel, (ii) une association de défense des consommateurs représentatives au niveau national et agréées en application de l'article L. 811-1 du code de la consommation, lorsque le traitement de données à caractère personnel affecte des consommateurs, (iii) une organisation syndicale de salariés ou de fonctionnaires représentative, au sens des articles L. 2122-1, L. 2122-5 ou L. 2122-9 du code du travail ou de l'article L. 222-2 du code général de la fonction publique, ou les syndicats représentatifs de magistrats de l'ordre judiciaire, lorsque le traitement affecte les intérêts des personnes que les statuts de cette organisation la chargent de défendre, (iv) une association ou une organisation dont l'objet statutaire est en relation avec la protection des droits et libertés lorsque ceux-ci sont méconnus dans le cadre d'un traitement de données à caractère personnel[[81]]url:#_ftn81 , ou (v) une association dont cette personne est membre et dont l'objet statutaire implique la défense d'intérêts en relation avec les finalités du traitement litigieux, aux fins d'exercer en son nom les droits prévus aux articles 77 à 79 et 82 du RGPD[[82]]url:#_ftn82 .
65. Entité qualifié et RGPD – Comme le RGPD est expressément visé dans l’Annexe 1 de la Directive, une entité qualifiée peut initier une action représentative transfrontière au titre d’une violation du RGPD. Le risque d’un concours d’actions représentatives entre plusieurs entités qualifiées de pays différents contre l’un des GAFAM est sinon probable au moins possible. Ni la directive ni la loi DADDUE ne prévoit de règle de droit applicable. L’article 2-3 de la Directive se contente de renvoyer aux règles de droit international privé « en particulier des règles relatives à la compétence ainsi qu’à la reconnaissance et à l’exécution des décisions en matière civile et commerciale et des règles relatives au droit applicable aux obligations contractuelles et non contractuelles ».
57. L’article 16-X-A commence par définir une « action de groupe » transfrontière, il aurait été préférable de parler d’ « action représentative » transfrontière. C’est une action de groupe « intentée devant une juridiction ou une autorité compétente d’un Etat membre de l’Union européenne autre que celui dans lequel le demandeur a été désigné », en application de l’article 4 de la Directive. Si cette condition est remplie, l’article 16-X détaille la procédure à ce type de procédure.
58. En comparant l’article 16-I-C relatif aux conditions d’obtention d’un agrément pour une association nationale et l’article 16-X-B relatif aux conditions pour être reconnue comme une entité qualifiée, on constate de très légères différences.
58.1 Première différence, l’activité minimale effective de 12 mois avant la délivrance du passeport reconnaissant leur qualité à agir concerne la « défense d’intérêts auxquels il a été porté atteinte » pour les associations nationales mais est cantonnée « à la protection des intérêts des consommateurs » pour les entités qualifiées. La loi DDADUE ne vise pas la protection des « intérêts collectifs des consommateurs » mais la simple « protection des intérêts des consommateurs ». Cette disparition de la locution « collective » n’est pas neutre car elle tend à étendre la qualité pour agir à la défense de « quelques » consommateurs lorsque l’intérêt « collectif » transcende les intérêts individuels. À la lumière de la Directive, il faut comprendre par consommateur : une personne physique concernée par l’un des textes visés à l’Annexe 1 de la directive.
58.2 Deuxième différence, la loi DDADUE réserve l’agrément à une « association à but non lucratif », ce qui semble exclure d’autres formes comme une fondation ou une fiducie. En revanche, pour les entités qualifiées, peu importe la forme, à partir du moment où elles respectent l’obligation de poursuivre un but non lucratif.
58.3 Troisième différence, comme l’entité qualifiée peut provenir d’un autre État membre, l’Article 16-X-B-4°) étend l’absence de procédure collective au titre du livre VI du code de commerce (français) à toute procédure d’insolvabilité reconnue par la réglementation européenne[[83]]url:#_ftn83
58.4 Quatrième différence, l’absence de conflits d’intérêts est plus précise pour les entités qualifiées. En effet, pour les association agréées, l’article 16-I-C-4°) que l’association est indépendante et « n’est pas influencée par des personnes, autres que celles dont elle défend les intérêts, ayant un intérêt économique dans l’introduction d’une action de groupe ». Quant aux entités qualifiées, l’article 16-X-B-5°) précise que les entités qualifiées sont bien sûr indépendantes et « ont pas influencées par des personnes autres que des consommateurs, en particulier par des professionnels, ayant un intérêt économique dans l’introduction d’une action représentative, y compris en cas de financement par des tiers ». Il semble que la crainte d’une instrumentalisation de l’action représentative par un concurrent soit plus forte pour les actions transfrontières.
59. Marge de manœuvre des États membres ? – D’après le rapport Brulebois[[84]]url:#_ftn84 , « La directive ne laisse pas de marge de manœuvre aux États membres s’agissant des critères de désignation des organismes ayant qualité pour agir en matière d’action de groupe transfrontière : dès lors qu’un organisme réunit les six critères, il doit être désigné comme organisme qualifié à intenter des actions de groupes transfrontières ».
60. Procédure de vérification de la qualité pour agir de l’entité qualifiée – Comme il est probable que les défendeurs cherchent à faire déclarer irrecevable en son action l’entité qualifiée en contestant sa qualité, l’article 16-X-C propose que la juridiction saisie d’une « contestation sérieuse » (ce qui exclut la contestation dilatoire ?) « peut demander à l’autorité compétente » française « de vérifier le respect, par le demandeur, des conditions d’agrément ». Dans ce cas, la loi prévoit un sursis à statuer jusqu’à la notification de l’autorité compétente. Si l’entité qualifiée appartient à un autre État membre, l’autorité compétente française « informe sans délai les autorités de l’État membre de l’Union européenne dans lequel cette entité qualifiée a été désignée ». C’est à l’autorité du pays d’origine de procéder « aux vérifications nécessaires ». L’autorité compétente transmet à la juridiction, dès sa réception, la réponse fournie par l’autre État membre de l’Union européenne. Ainsi, la loi ne prévoit pas de saisine directe de l’autorité compétente d’un autre État membre par une juridiction saisie d’une « contestation sérieuse ». Pour autant, le rôle de l’autorité compétente française est réduit à celui de « petit télégraphiste » sans que la loi lui reconnaisse l’office de filtrer les demandes. De même, le caractère sérieux de la contestation n’est pas apprécié par l’autorité compétente française mais par la juridiction saisie. On le voit, le texte permet des discussions sans fin qui n’auront d’autres effets de ralentir le char de la justice.
61. Possibilité de retrait - Enfin, l’article 16-X-D prévoit une possibilité pour l’autorité compétente de retirer sa qualité à une entité qualifiée si elle n’est plus en mesure de continuer à respecter « les critères auxquels est subordonnée l’attribution de son agrément » ou, « en cas de non-respect ». L’autorité compétente ne peut pas être saisie directement ni par le défendeur ni par la juridiction en charge de l’action. Cette demande ne peut émaner que de la Commission européenne ou d’un État membre de l’Union européenne.
a) Éléments communs aux deux procédures
(i) Création de nouvelles juridictions spécialisées
62. Action de groupe et ordre de juridiction – L’article 16-V dispose que « les actions de groupe sont portées devant l’ordre de juridiction compétent pour en connaître ». Il n’y a pas de nouveauté de ce côté.
63. Tribunaux judiciaires spécialisés – L’article 16-VI prévoit de modifier l’article L. 211-15 du code de l’organisation judiciaire de telle sorte que des tribunaux judiciaires spécialement désignés, par décret, connaissent des actions de groupe engagées « en toutes matières ». Le Décret n° 2025-653 du 16 juillet 2025 désigne les tribunaux judiciaires compétents en matière d'action de groupe (Cf. Tableau 3). Ils sont au nombre de 8 pour 36 ressorts de cour d’appel. Le découpage ne correspond ni au découpage par région ni au découpage judiciaire.
Selon Omar Kafi-Cherrat[[85]]url:#_ftn85 , cette spécialisation est destinée « à pallier les lenteurs de l’action de groupe ». Dans la pratique, il a fallu 6 ans au tribunal judiciaire de Paris pour apprécier la recevabilité de l’action de groupe dans l’affaire DEPAKINE et condamné l’industriel[[86]]url:#_ftn86 . Si cette spécialisation peut paraître « heureuse »[[87]]url:#_ftn87 , on peut douter de son efficacité tant la loi DDADUE contient des pièges et arguties de procédure qui permettront aux défendeurs de faire perdre un temps précieux et aux victimes et à la justice.
Le Décret du 30 juillet 2025, qui modifie, entre autres le code de procédure civile et le code de justice administrative, n’a pas modifié l’article 849 du code de procédure civile. De telle sorte que « Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui du lieu où demeure le défendeur. » La conjonction des décrets du 16 juillet 2025 et 30 juillet 2025 nous conduit à penser que le tribunal compétent est le tribunal spécialisé le plus proche de celui où demeure le défendeur. Si une entreprise est basée à Toulouse, le tribunal compétent devrait être celui de Bordeaux.
64. Absence de création d’une juridiction commerciale spécialisée - La loi DDADUE ne prévoit pas de confier à un tribunal de commerce (ou un tribunal des affaires économiques) spécialisé le soin de traiter les actions de groupe en matière de pratiques anticoncurrentielles en droit interne ou en droit européen. Tout au plus, l’article 16-VIII prévoit-il que « lorsque les manquements reprochés portent sur le respect des règles définies au titre II du livre IV du code de commerce ou des articles 101[[88]]url:#_ftn88 et 102[[89]]url:#_ftn89 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la responsabilité du professionnel ne peut être prononcée dans le cadre d’une action de groupe que sur le fondement d’une décision prononcée à l’encontre du professionnel par les autorités ou les juridictions nationales ou de l’Union européenne compétentes, qui constate les manquements et qui n’est plus susceptible de recours pour la partie relative à l’établissement des manquements ». Autrement dit, la juridiction judiciaire n’a pas à se prononcer sur l’existence et la qualification de la pratique anticoncurrentielle. Nous sommes en présence d’une action « follow-on »[[90]]url:#_ftn90 .
En revanche, la juridiction judiciaire spécialisée est compétente pour apprécier les préjudices subis par les victimes et résultant de la pratique anticoncurrentielle sanctionnée par les autorités de la concurrence. L’alinéa 2 de l’article 16-VIII précise en outre que l’action de groupe ne peut être engagée « plus de cinq ans » après la date à laquelle la décision de l’autorité de concurrence (ou la juridiction compétente en la matière) n’est plus susceptible de recours.
65. Absence de juridiction administrative spécialisée – L’article 16-XVII-4°) abroge les articles L. 77-10-2 à L. 77-10-25 du Code de justice administrative et ne laisse subsister qu’un article L. 77-10-1 qui renvoie expressément au tronc commun de l’action de groupe régi par les articles I à XI de l’article 16 de la loi DDADUE. Toutefois, devant les juridictions administratives, l’Article 16-XIII prévoit que le ministère public ne peut pas être partie (principale ou jointe) à une action de groupe contre l’État (article 4 du C du I de l’article 16[[91]]url:#_ftn91 ). De même, un juge ne peut pas ordonner à l’encontre d’une personne morale dépendant de la juridiction administrative « toutes les mesures provisoires utiles pour faire cesser le manquement allégué, dans un délai qu’il fixe, afin de prévenir un dommage imminent ou de faire cesser un trouble manifestement illicite » (3e alinéa du II de l’article 16). Enfin, les associations agréées peuvent participer à une médiation[[92]]url:#_ftn92 « afin d’obtenir la réparation des préjudices individuels » (le 1 du C du III de l’article 16). Cela signifie, a contrario, que les autres personnes visées à l’article 16-I-C (organisations syndicales d’employeurs ou de salariés ; entité qualifiée) ne peuvent pas participer à une telle médiation. Contrairement aux juridictions judiciaires, la loi DDADUE n’a pas prévu la création d’une juridiction administrative spécialisée. D’après les statistiques publiées par le Conseil d’État, au 18 avril 2025, il n’y aurait eu que 14 actions de groupe administratives[[93]]url:#_ftn93 . Peut-être ce chiffre est-il insuffisant pour justifier la création d’une juridiction spécialisée en matière administrative.
66. Détermination de la juridiction compétente – Le Décret du 30 juillet 2025 est venue complétement refondre les articles R 77-10-1 à R 77-10-22 du code de justice administrative. Lorsque les demandeurs à une action de groupe auraient relevé en application du droit commun d’une seule juridiction administrative, « cette juridiction est compétente pour connaître de cette action » (article R 77-10-2 alinéa 1). Si plusieurs juridictions étaient concernées alors « l'action de groupe est adressée au Conseil d'État » (article R 77-10-2 alinéa 2). Si le Conseil d’État n’a pas été saisi directement, il appartient au président de la juridiction saisie de lui transmettre le dossier (alinéa 3). C’est le président de la section du contentieux du Conseil d’État qui détermine la juridiction compétente et informe toutes les juridictions concernées (alinéa 4). En cas de pluralité d’action de groupe « ayant le même objet », les procédures doivent être transmises à la juridiction désignée. Si une cour administrative d’appel est déjà saisie d’une requête dirigée contre un jugement rendu par un tribunal administratif sur une action de groupe ayant le même objet, le président de la section du Contentieux du Conseil d’État renvoie toutes les actions de groupe vers la cour d’appel déjà saisie. « La cour administrative d'appel statue alors en premier et dernier ressort ».
67. Maintien de l’action en reconnaissance de droit - A noter que la loi DDADUE n’a pas modifié l’action en reconnaissance de droit créée par l’article 93 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle. Ainsi, l’article L. 77-12-1 du code de justice administrative précise qu’une action en reconnaissance de droits vise à faire reconnaître des droits individuels pour un groupe de personnes ayant le même intérêt. Elle ne peut pas avoir pour objet de reconnaître un préjudice, mais peut seulement tendre à obtenir le versement d’une somme d’argent légalement due (par exemple une prime pour des fonctionnaires) ou la décharge d’une somme d’argent illégalement réclamée (telle qu’une contribution fiscale)[[94]]url:#_ftn94 . Cette action est réservée à « une association régulièrement déclarée ou à un syndicat professionnel régulièrement constitué » Ainsi, pour cette procédure, qualifiée d’action collective sur le site du Conseil d’État, les exigences d’agrément voire d’ancienneté dans l’existence de l’association ne sont pas requises.
68. Nécessité de consulter les caisses d’assurance maladie en cas de règlement amiable – L’article 16-VII prévoit qu’en matière de réparation de préjudices résultant de dommages corporels, le règlement amiable intervenant entre le responsable et le demandeur ou ses ayants droit et le jugement statuant sur les droits à indemnisation du demandeur ou de ses ayants droit sont soumis, selon le cas, aux caisses d’assurance maladie à laquelle le bénéficiaire appartient.
(ii) Rejet d’une procédure « manifestement infondée » (distinct de l’irrecevabilité)
69. Pouvoir de filtrage des juridictions – Peut-être par crainte des dérives américaines dénoncées par certains auteurs proches du Big Business[[95]]url:#_ftn95 , la loi DDADUE renforce le pouvoir du juge. Ainsi, en plus des fins de non-recevoir classiques[[96]]url:#_ftn96 , l’article 16-I-G introduit une procédure de rejet pour une « action manifestement infondée ». Dans ce cas, la juridiction spécialement motivée sa décision « dès l’introduction de l’instance, selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État ». Nous attendons ces précisions pour commenter plus avant.
(iii) Prescription
70. Inspiration européenne – L’article 16 de la Directive est consacré aux « délais de prescription ». Dans le cadre d’une action représentative en cessation, l’alinéa 1er recommande aux États membres de faire en sorte que l’action « ait pour effet de suspendre ou d’interrompre les délais de prescription applicables à l’égard des consommateurs concernés par ladite action représentative, de sorte que ces derniers ne soient pas empêchés d’intenter par la suite une action visant à obtenir des mesures de réparation concernant l’infraction alléguée visée à l’article 2, paragraphe 1, au motif que les délais de prescription applicables ont expiré au cours de l’action représentative visant à obtenir ladite mesure de cessation ». De son côté, l’alinéa 2 du même article prévoit qu’en présence d’une action représentative visant à obtenir réparation, les règles nationales doivent avoir « pour effet de suspendre ou d’interrompre les délais de prescription applicables à l’égard des consommateurs concernés par cette action représentative ». Le § 66 du préambule précise que « Afin de garantir la sécurité juridique, la suspension ou l’interruption des délais de prescription imposés conformément à la présente directive devrait s’appliquer uniquement aux demandes de réparation fondées sur des infractions qui ont été commises le 25 juin 2023 ou après cette date. Cela ne devrait pas faire obstacle à l’application des dispositions nationales relatives à la suspension ou à l’interruption des délais de prescription qui s’appliquaient avant le 25 juin 2023 aux demandes de réparation fondées sur des infractions commises avant cette date ». Cette volonté se traduit dans l’article 22 alinéa 3 de la Directive.
71. Transposition française : interruption erga omnes - L’article 16-IX-A alinéa 1 de la loi DDADUE précise que l’action de groupe (en manquement ou en réparation) « suspend la prescription des actions individuelles en réparation des préjudices résultant des manquements constatés par le juge ou des faits retenus dans l’accord homologué ».
Ainsi, une action de groupe profite à tous les créanciers potentiels, même s’ils préfèrent agir seuls ou hors de l’action de groupe. Cette clarification met fin à des débats doctrinaux que la jurisprudence de la Cour de cassation n’avait pas eu à trancher, faute de décisions en la matière.
72. Computation de la prescription après la fin de l’interruption - Inspiré par les articles 2238 alinéa 2 et 2241 du code civil, l’article 16-IX-A alinéa 2 précise que « le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle le jugement n’est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation ou à compter de la date de l’homologation de l’accord ».
73. Interruption circonscrite – L’interruption de la prescription est limité aux « manquements constatés par le juge ou des faits retenus dans l’accord homologué ». Cette précision peut avoir son importance dans le cadre du maintien du droit d’actions pour les préjudices hors champ.
(iv) Autorité de la chose jugée et effet relatif de l’appartenance au groupe
74. Autorité de la chose jugée relative – L’article 16-IX-B énonce que « le jugement sur la responsabilité et le jugement d’homologation de l’accord ont autorité de la chose jugée à l’égard de chacun des membres du groupe dont le préjudice a été réparé au terme de la procédure ».
75. Maintien des droits d’action pour les préjudices hors champ – L’article 16-IX- C dispose que « l’adhésion au groupe ne fait pas obstacle au droit d’agir selon les voies de droit commun pour obtenir la réparation des préjudices ne relevant pas du champ défini par le jugement sur la responsabilité qui n’est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation ou dans le champ d’un accord homologué ». Il conviendra d’être particulièrement vigilant. En effet, l’adhésion au groupe ne peut survenir qu’après le jugement sur la responsabilité (article 16-III-B-1.a). Si, une victime souhaite être indemnisée d’un préjudice hors du champ d’application du jugement ou de l’accord homologué, elle doit avoir poursuivi le défendeur de ce chef avant le jugement. En effet, l’interruption de la prescription ne concerne que les faits constatés dans le jugement ou retenus dans l’accord homologué.
76. Action de groupe sur action de groupe ne vaut – L’article 16-IX-D. dispose que « n’est pas recevable l’action de groupe qui se fonde sur le même fait générateur, le même manquement et la réparation des mêmes préjudices que ceux reconnus par le jugement sur la responsabilité ou par un accord homologué ».
(v) Faculté de substitution en cas de défaillance du demandeur initial
77. Sauvetage d’une action de groupe en cas de défaillance du demandeur – L’article 16-IX-E dispose que « lorsque le juge a été saisi d’une action de groupe et que le demandeur à l’action est défaillant, toute personne ayant qualité pour agir à titre principal peut demander au juge sa substitution dans les droits du demandeur ». Que faut-il entendre par défaillance ? De même, le texte ne précise ni les formes ni les délais de cette substitution. Par ailleurs, la loi ne mentionne pas à quel moment de la procédure la substitution peut intervenir. Ainsi, si une première association agréée à présenter des cas individuels au soutien de ses prétentions (article 16-III-A-1), le plus souvent ces cas émaneront de membres de l’association. En cas de défaillance, l’association substituée pourra-t-elle se prévaloir des cas individuels d’une autre association ? Les personnes physiques derrière les cas individuels devront-elles donner leur accord pour être présentées par la nouvelle association ou seront-elles embarquées, nolens volens, dans une procédure avec une association avec laquelle elles n’entretiennent aucun lien de fait ou de droit ?
L’article 829-21 du code de procédure civile et l’article R77-10-22 du code de justice administrative, dans leur rédaction issue du Décret du 30 juillet 2025, précisent les conditions de sauvetage :
- la substitution est faite par voie « de demande incidente ».
- S’il fait droit à la demande et si une demande en ce sens lui a été expressément présentée, le juge « statue sur le transfert de la provision » qui aurait pu être allouée en application de l’article 16 III A 2 3e alinéa.
- La substitution emporte transfert du mandat donné par les personnes intéressées au demandeur substitué. Enfin, le demandeur défaillant est tenu de remettre les pièces ainsi que les fonds détenus, le cas échéant pour le compte des personnes intéressées, au demandeur qui lui est substitué qui en accuse réception.
- Tant que cette remise n'a pas lieu, le demandeur défaillant n'est pas déchargé de ses obligations.
(vi) Caractère d’ordre public de l’action de groupe mais caractère subsidiaire
78. Protection contre les « class actions waivers » - L’article 16-VIII-F. dispose qu’« est réputée non écrite toute clause ayant pour objet ou pour effet d’interdire à une personne de participer à une action de groupe ». Cette précision est bienvenue. En effet, aux USA, pour se protéger les entreprises ont pris l’habitude d’insérer dans leurs contrats des « class action waivers » qui interdisent aux consommateurs de recourir à une class action. Cette pratique a été reconnue valable par la Cour suprême américaine dans son arrêt ATT Mobility vs Concepcion (2011).
(vii) Action directe contre l’assureur du responsable
79. Action directe au profit du « demandeur » et non des bénéficiaires - A toutes fins utiles, l’article 16-VIII dispose que « le demandeur à l’action peut agir directement contre l’assureur garantissant la responsabilité civile du responsable en application de l’article L. 124-3 du code des assurances ».
(viii) Mesures de publicité à la charge du demandeur en cas d’irrecevabilité
80. Une sanction couteuse contre les demandes abusives ? - Le juge qui déclare l’action irrecevable ou la rejette « ordonne, à la charge du demandeur, les mesures de publicité adaptées pour informer de cette décision les personnes susceptibles d’être concernées par l’action » (Article 16-II al. 4 et 16-III-A-1 al. 6). Outre les fins de non-recevoir classiques (articles 122 à 126 du code de procédure civile : défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée), l’article 16-I.E peut déclarer irrecevable l’action d’un demandeur défaillant dans la démonstration d’absence de conflit d’intérêts. Les associations agréées et les syndicats doivent se montrer vigilants. En effet, le demandeur défaillant peut avoir à supporter outre les frais et dépens de la procédure les mesures de publicité adaptées. Compte tenu du déséquilibre économique existant entre les demandeurs et les défendeurs, cela peut constituer une arme à double tranchant qui peut conduire les demandeurs à hésiter à lancer une action de groupe de principe.
b) La procédure en cessation de manquement
(i) Cas général
81. Mieux vaut prévenir que guérir – Pour initier une procédure en cessation d’un manquement, l’Article 16-II prévoit que « le demandeur n’est tenu d’établir ni un préjudice pour les membres du groupe, ni l’intention ou la négligence du défendeur ».
82. Compétence concurrente du juge des référés et du juge de la mise en état ? – L’article 16-II ne fait pas expressément référence au juge des référés mais il parle soit du « juge » soit du « juge de la mise en état ». L’article 8-1-a) de la Directive faisait lui, référence à des « mesures provisoires ordonnant la cessation ou l’interdiction d’une pratique illégale ». Selon nous, il faut comprendre que le juge des référés demeure compétent dans les conditions de droit commun régies par les articles 834 et 835 du code de procédure civile[[97]]url:#_ftn97 . Le juge doit d’abord constater l’existence du manquement. Ensuite, il a le choix des mesures correctives : soit enjoindre au défendeur de cesser ou de faire cesser le manquement ; soit de prendre, dans un délai qu’il fixe, toutes les mesures utiles à cette fin, au besoin avec l’aide d’un tiers qu’il désigne
La loi lui reconnait la possibilité de prononcer une astreinte, étant précisé que sa liquidation bénéficiera à « un fonds consacré au financement des actions de groupe » (article 16-II alinéa 2).
L’article 16-II-alinéa reconnait au juge de la mise en état la possibilité d’ordonner « toutes les mesures provisoires utiles pour faire cesser le manquement allégué, dans un délai qu’il fixe, afin de prévenir un dommage imminent ou de faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Afin d’informer de sa décision les personnes susceptibles d’être concernées par les manquements constatés, « le juge ordonne, à la charge du défendeur, les mesures de publicité adaptées ». Toutefois, « ces mesures de publicité ne peuvent être mises en œuvre qu’une fois que l’ordonnance n’est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation » (article 16-II alinéa 6.)
c) La procédure en réparation
83. Valse à deux temps en remplacement de la « valse a mis le temps » - Dans le rapport Brulebois-Thiebaut[[98]]url:#_ftn98 , il est précisé que la procédure en réparation se caractérise par une « césure obligatoire » entre une phase qui oppose le demandeur et le défendeur au cours de laquelle le juge doit statuer sur la responsabilité de ce dernier (i) et une phase d’indemnisation, individuelle ou collective (iii), étant précisé que la loi prévoit diverses mesures de publicité (ii).
(i) Le jugement sur la responsabilité
84. Préalable au jugement - L’article 16-III-A-1 prévoit que le demandeur à une action en réparation des préjudice subis « présente des cas individuels au soutien de ses prétentions ». La loi est muette sur le nombre de cas individuels. S’agit-il d’un échantillon ? Doit-il être représentatif ? Deux cas individuels suffisent-ils ? L’idée sous-jacente est de permettre au juge de déterminer la consistance des groupes. Par ailleurs, en matière sociale, il conviendra de respecter la mise en demeure préalable.
85. Duel entre le demandeur et le défendeur – Dans cette phase, le débat se concentre entre deux protagonistes. Il s’agit d’éviter que la justice soit « embouteillée » par une profusion de demandes individuelles que les greffes ont du mal à gérer. On se retrouve fictivement dans un débat contradictoire avec deux interlocuteurs. Le défendeur tentera d’éviter la reconnaissance de sa responsabilité en menant une guerre de tranchées sur la recevabilité de l’action (fins de non-recevoir classiques), illégitimité du demandeur, absence de cas individuels pour déterminer si une action de groupe est possible. Cette procédure peut être longue comme cela a été le cas dans le dossier DEPAKINE. On aurait pu espérer que le législateur encadre l’appréciation de la recevabilité en exigeant du défendeur le respect d’un principe de concentration et en demandant au juge de statuer dans les 2 ans de sa saisine. Cela éviterait les débats sans fin où une fin de non-recevoir chasse l’autre qui a fait l’objet d’un rejet. C’est ainsi que pour chaque fin de non-recevoir invoquée, on peut perdre de 9 à 18 mois…
Contrairement à l’article 16-II alinéa 3 autorisant le juge de la mise en état à prendre « toutes les mesures provisoires utiles pour faire cesser le manquement allégué », la loi DDADUE ne prévoit aucune prérogative spéciale pour le juge de la mise en état.
86. Possibilité d’octroi d’une provision - Les provisions prévues par l’article 16-III-A-2 al. 3 semblent réservées au juge statuant sur la responsabilité, ce qui évince le juge de la mise en état. à l’exception des dommages corporels, « le juge peut également condamner le défendeur au paiement d’une provision à valoir sur les frais non compris dans les dépens exposés par le demandeur à l’action, y compris les frais d’assistance afférents à la gestion des demandes d’indemnisation présentées par les membres du groupe pour la mise en œuvre de la phase de liquidation des préjudices »
87. Office du juge - La loi poursuit en affirmant cette évidence : « Le juge statue sur la responsabilité du défendeur » (article 16-III-A-1 al. 2). C’est donc le droit commun de la responsabilité (civile ou administrative) qui s’appliquera suivant les faits de l’espèce. Mais, l’article 16-III-A.3 précise que « Lorsqu’il statue sur la responsabilité, le juge peut ordonner, lorsqu’il la juge nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, la consignation à la Caisse des dépôts et consignations d’une partie des sommes dues par le défendeur ».
Une fois, la responsabilité établie, le juge définit le groupe de personnes à l’égard desquelles la responsabilité du défendeur est engagée, « en fixant les critères de rattachement au groupe, et détermine les préjudices devant faire l’objet d’une réparation, pour chacune des catégories de personnes constituant le groupe qu’il a défini » (article 16-III-A-1 al. 3).
88. Accélération procédurale ? - En rupture avec le droit antérieur, l’article 16-III-A-1 al. 4 prévoit que, lorsque les éléments produits et la nature des préjudices le permettent, le juge détermine, « dans le même jugement » le montant ou tous les éléments permettant l’évaluation des préjudices susceptibles d’être réparés, pour chacune des catégories de personnes constituant le groupe qu’il a défini.
89. Le juge définit groupe(s) et sous-groupe(s) et règlemente les conditions d’indemnisation (hors règlement amiable) – Après avoir défini les critères de rattachement, le juge fixe également le délai dans lequel les personnes répondant aux critères et souhaitant « se prévaloir du jugement sur la responsabilité peuvent adhérer au groupe en vue d’obtenir la réparation de leur préjudice » (article 16-III-A-1 al. 7). La loi prévoit expressément que ce délai ne peut être inférieur à deux mois, ni supérieur à cinq ans à compter de l’achèvement des mesures de publicité ordonnées par le juge.
Le juge fixe le délai dont dispose le défendeur condamné pour procéder à l’indemnisation ainsi que les conditions et les limites dans lesquelles les personnes ayant adhéré au groupe peuvent saisir le juge aux fins d’obtenir une indemnisation individuelle.
Sauf en matière de dommages corporels, le juge peut ordonner une « réparation en nature du préjudice », si cela lui paraît plus adaptée. Il doit alors préciser les conditions de sa mise en œuvre par le défendeur.
(ii) Liquidation individuelle des préjudice ou l’opt-in différé
90. Option des bénéficiaires quant au destinataire de la demande indemnitaire - L’article 16-III-B-1.a alinéa 1 prévoit que chaque « victime », non partie à la procédure par définition, peut réclamer son indemnité doit vérifier si elle appartient au groupe défini par le jugement. Pour être indemnisé, il faut adhérer au groupe en adressant une demande de réparation « soit à la personne déclarée responsable par ce jugement, soit au demandeur à l’action, qui reçoit ainsi mandat aux fins d’indemnisation ».
91. La solution pour contourner nul de plaide par procureur : le mandat ad litem a posteriori - L’article 16-III-B-1.a alinéa 2 précise que « Ce mandat ne vaut ni n’implique adhésion à l’association ou à l’organisation syndicale demanderesse. Il est donné aux fins de représentation pour l’exercice de l’action de groupe et, le cas échéant, pour faire procéder à l’exécution forcée du jugement prononcé à l’issue de la procédure. »
(iii) Liquidation collective des préjudices
92. Article 16-III-A.2. procédure collective de liquidation des préjudices à l’exclusion des actions de groupe tendant à la réparation de préjudices résultant de dommages corporels – « lorsque le demandeur à l’action le demande et que les éléments produits ainsi que la nature des préjudices le permettent » (alinéa1), le juge peut mettre en œuvre une procédure collective de liquidation des préjudices. Le demandeur reçoit l’habilitation du juge pour négocier avec le défendeur l’indemnisation des préjudices subis par chacune des personnes constituant le groupe. Cette négociation est strictement encadrée par le juge. En effet, il détermine, dans le même jugement, d’un part, le montant de ces préjudices ou, à défaut, les éléments permettant leur évaluation, pour chacune des catégories de personnes constituant le groupe qu’il a identifié et d’autre part, il définit les délais et les modalités selon lesquels cette négociation et cette évaluation doivent être effectuées, notamment le délai, qui ne peut être inférieur à six mois, « à l’expiration duquel, en l’absence d’accord, il statue directement sur les préjudices susceptibles d’être réparés ».
93 Absence d’effet erga omnes – L’article 16-IX-B dispose que « le jugement sur la responsabilité et le jugement d’homologation de l’accord ont autorité de la chose jugée à l’égard de chacun des membres du groupe dont le préjudice a été réparé au terme de la procédure ».
* *
*
94. Une avancée timide et imparfaite – En guise de conclusions sur cette présentation, on peut retenir plusieurs éléments contradictoires : la loi DDADUE comprend d’incontestables avancées et tend à unifier le droit de l’action de groupe mais elle contient des conditions d’accès extrêmement restrictives qui rendent peu probable un réel engouement. On peut comme les professeurs Azar-Baud et Magnier[[99]]url:#_ftn99 s’armer d’espoir mais il parait préférable de préparer la prochaine loi rendue nécessaire tant les critiques sont nombreuses et convergentes comme nous allons le démontrer dans une troisième et dernière partie (à paraitre).
Annexe 1 :
DROIT DE LA CONSOMMATION EN DROIT EUROPEEN
(Une nouvelle présentation de l’annexe I de la Directive 2020-1828 sur les actions représentatives)
| PRODUITS - SERVICES Directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux Directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges Directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité Directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie Règlement (CE) no 1222/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’étiquetage des pneumatiques en relation avec l’efficacité en carburant et d’autres paramètres essentiels Directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels Directive 2014/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tensions Règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l’étiquetage énergétique | SANTE – ALIMENTATION Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires Règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques Règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires Règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, Règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro |
| BANQUE – FINANCE Directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs ; Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) Règlement (CE) no 924/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant les paiements transfrontaliers dans la Communauté Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatif Règlement (UE) no 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros Directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers Directive 2014/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur la comparabilité des frais liés aux comptes de paiement, le changement de compte de paiement et l’accès à un compte de paiement assorti de prestations de base Règlement (UE) no 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 sur les documents d’informations clés relatifs aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance Règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d’investissement à long terme Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur Directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d’assurances Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé Règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur les fonds monétaires | TRANSPORTS – VOYAGES - TOURISME Règlement (CE) no 2027/97 du Conseil du 9 octobre 1997 relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en ce qui concerne le transport aérien de passagers et de leurs bagages Règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol ; Règlement (CE) no 1107/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu’elles font des voyages aériens Règlement (CE) no 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires Règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté Règlement (CE) no 392/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à la responsabilité des transporteurs de passagers par mer en cas d’accident Règlement (UE) no 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure Règlement (UE) no 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar Directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées |
| CONSOMMATION INFORMATION ET PROTECTION Directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs Directive 98/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 relative à la protection des consommateurs en matière d’indication des prix des produits offerts aux consommateurs Directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur Directive 2006/114/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur Directive 2008/122/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 janvier 2009 relative à la protection des consommateurs en ce qui concerne certains aspects des contrats d’utilisation de biens à temps partagé, des contrats de produits de vacances à long terme et des contrats de revente et d’échange Règlement (CE) no 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l’UE Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique Directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation Règlement (UE) no 524/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au règlement en ligne des litiges de consommation Directive 2014/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des instruments de pesage à fonctionnement non automatique Directive (UE) 2019/771 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de vente de biens, | COMMERCE ELECTRONIQUE – RESEAUX – TELEPHONIE – DONNEES Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique») Directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel») Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) Règlement (UE) no 531/2012 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012 concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union Règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l’accès à un internet ouvert et aux prix de détail pour les communications à l’intérieur de l’Union européenne Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation (RGPD) Règlement (UE) 2017/1128 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relatif à la portabilité transfrontalière des services de contenu en ligne Règlement (UE) 2018/302 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2018 visant à contrer le blocage géographique injustifié et d’autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d’établissement des clients dans le marché intérieur Directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen Directive (UE) 2019/770 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de fourniture de contenus numériques et de services numériques |
Tableau 1
Annexe 2 - Les sept fondements juridiques en matière d'action de groupe (avant 2025)
| Type d'action de groupe | Loi ayant créé le type d'action de groupe | Dispositions en vigueur régissant | Juge compétent |
| Action de groupe | Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation | Articles L. 623-1 à L. 623-32 du code de la consommation. | Juge judiciaire |
| Action de groupe | Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé. | Articles L. 1143-1 à L. 1143-13 du code de la santé publique. | Juge administratif ou judiciaire |
| Action de groupe | Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle. | Article 10 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. | Juge administratif ou judiciaire |
| Action de groupe | Articles L. 1134-6 à L. 1134-10 du code du travail. | Juge judiciaire | |
| Action de groupe | Articles L. 77-11-1 à L. 77-11-6 du code de justice administrative. | Juge administratif | |
| Action de groupe | Article L. 142-3-1 du code de l'environnement. | Juge administratif ou judiciaire | |
| Action de groupe | Article 37 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. | Juge administratif ou judiciaire |
Source : commission des lois de l'Assemblée nationale10(* )
Annexe 3 – Tribunaux compétents en matière d’action de groupe
[[1]]url:#_ftnref1 Mauro Cappelletti, La protection d'intérêts collectifs et de groupe dans le procès civil (Métamorphoses de la procédure civile). Revue internationale de droit comparé. Vol. 27 N°3, Juillet-septembre 1975. pp. 571-597 - https://www.persee.fr/doc/ridc_0035-3337_1975_num_27_3_16426.
[[2]]url:#_ftnref2 Roger Perrot, « L'action en justice des syndicats professionnels, des associations et des ordres professionnels », dans Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvö's Nominatae. Sectio juridica, X, Badapest, 1969, pp. 99-106
[[3]]url:#_ftnref3 « (1) La mondialisation et la numérisation de l’économie ont augmenté le risque qu’un grand nombre de consommateurs soient lésés par la même pratique illicite. Les infractions au droit de l’Union peuvent porter préjudice aux consommateurs. Sans moyens efficaces pour les consommateurs de mettre un terme aux pratiques illicites et d’obtenir réparation, la confiance des consommateurs dans le marché intérieur est amoindrie. (2) L’absence de moyens efficaces pour faire respecter le droit de l’Union protégeant les consommateurs pourrait également entraîner une distorsion de l’équité de la concurrence entre les professionnels en infraction et les professionnels respectueux du droit qui exercent leurs activités dans leur pays ou par-delà les frontières. De telles distorsions peuvent entraver le bon fonctionnement du marché intérieur. »
[[4]]url:#_ftnref4 PE et Cons. UE, dir. n° 2020/1828, 25 nov. 2020 , relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE : A. Biard, « Action de groupe – Transposition de la directive UE 2020/1828 sur les actions représentatives : corriger le tir », Contrats, conc. consom. 2023, n° 3 ; P. Métais et E. Valette, « Approche européenne en matière de recours collectifs pour la protection des intérêts collectifs des consommateurs – une modification législative imminente ? », JCP E 2019, n° 1251. J.-D. Pelletier, « Regard sur la directive du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs », RDC juin 2021, n° RDC200c0 . S. Bernheim-Desvaux, « La Commission européenne annonce une nouvelle donne pour les consommateurs », Contrats, conc. consom. 2018, comm. 120 ; J.-D. Pellier, « Une nouvelle donne pour les consommateurs ! », RDC 2018, n° 115m5, p. 422 ; L. Usunier, « Nouvelle donne européenne pour les consommateurs », RTD civ. 2018, p. 854. P. Le More, « La directive action de groupe européenne : une volonté contradictoire à l'œuvre », Contrats, conc. consom. 2021, alerte 22. M. J. Azar-Baud, « La directive européenne sur les actions représentatives : un texte mi-figue, mi-raisin », JCP E 2020, 1542, n° 19 : « Les PME et les collectivités territoriales, souvent victimes des mêmes agissements provocateurs des dommages de masse, sont ainsi laissées de côté ». Y. Broussolle, Les principales dispositions de la directive relative aux actions représentatives, LPA, 16 février 2021, ,° 159f6, p. 15 et s ? M.-J. Azar-Baud, La directive européenne sur les actions représentatives : un texte mi-figue, mi-raisin : JCP E 2020, 1542. M.-J. Azar-Baud, Allegro ma non troppo (à propos de la transposition en France de la directive sur les actions représentatives en protection des intérêts collectifs des consommateurs) : D. 2021, p. 232.
[[5]]url:#_ftnref5 Dans un article caustique (Plaidons par procureur !, RTD civ. 1985, p. 247 et s.), le Professeur Francis Caballero dénonçait en 1985 « l’archaïsme procédural » de la procédure civile confrontée à la réalité des actions collectives. Il soulignait également le fait que la jurisprudence savait trouver des exceptions opportunes à l’adage suivant les intérêts en cause. « La répartition des espèces en fonction du poids politique ou économique des demandeurs est presque caricaturale (…) ainsi ont vu échouer leurs efforts de regroupements derrière un représentant : des syndicalistes, des petits salariés (dockers, femmes de ménage, policiers), des acquéreurs victimes de malfaçons dans la construction, des petits actionnaires. Ont en revanche bénéficié de la tolérance du contrôle judiciaire : des patrons, des notaires, des représentants d’assurances (…) ainsi que des propriétaires. (…) dans le fameux arrêt FERRODO [Cass. Soc. 17 mai 1977, pourvoi n° 75-11-474, publié au Bulletin], [la cour de cassation] casse une décision refusant à un employeur le droit de citer seulement six délégués du personnel pour obtenir l’expulsion de centaines de salariés « en raison de la difficulté pratique d’appeler individuellement à la cause tous les occupants et de la possibilité pour les dirigeants de fait du mouvement de grève de présenter les moyens de défense communs à l’ensemble du personnel (…) L’ironie du sort veut que, sans le savoir, la Cour formule les principes de base de l’action de groupe : la similarité des situations juridiques et la représentativité du demandeur à l’action »
[[6]]url:#_ftnref6 Cass. crim., 20 mai 2015 , n° 14-81.147 : JurisData n° 2015 -011901 ; D. 2015 , p. 1101, JCP (G) n° 28, 13 juillet 2015, act. 831, Note J.-B. Perrier ; N. Dissaux, Des mandats par milliers…, Recueil Dalloz 2015 p.1419 « Aucun texte n'interdit de donner mandat à un tiers de présenter une requête en restitution dès lors que l'existence de ce mandat est prouvée et que le nom du mandant figure dans chaque acte de procédure effectué pour le mandataire » – En l’espèce, l’association AFER avait présenté les mandats individuels de 55 114 de ses adhérents.
[[7]]url:#_ftnref7 L. Boré, La défense des intérêts collectifs par les associations devant les juridictions administratives et judiciaires, LGDJ, 1995, Bibl. dr. pr. t. 278, n° 353 « La class action est une action introduite par un représentant pour le compte de tout une classe de personnes ayant des droits identiques ou similaires qui aboutit au prononcé d’un jugement ayant autorité de chose jugée à l’égard de tous les membres de la classe ».
[[8]]url:#_ftnref8 Florence Laroche-Gisserot, Les class actions américaines, LPA 10 juin 2005, p. 7 - Dimitri Houtcieff , Les class actions devant le juge français : rêve ou cauchemar ?, LPA 10 juin 2005, p. 42 – Nous étudierons plus en détail dans la 3e partie le fonctionnement des class actions.
[[9]]url:#_ftnref9 L’article 3-4°) les définit comme « toute organisation ou tout organisme public représentant les intérêts des consommateurs qui a été désigné par un État membre comme étant qualifié pour intenter des actions représentatives conformément à la présente directive ».
[[10]]url:#_ftnref10 A. Biard, Transposition de la directive UE 2020/1828 sur les actions représentatives : corriger le tir, Contrats Concurrence Consommation n° 3, Mars 2023, alerte 9
[[11]]url:#_ftnref11 C’est la summa divisio en la matière : dans un procédure opt-out (comme aux USA) une personne (et pas forcément une association ou un syndicat) se voit reconnaître par le juge le droit d’agir pour l’ensemble du groupe défini par la juridiction sur des critères objectifs. Une décision de justice peut être rendue en votre nom « à l’insu de son plein gré », sans que cela vous engage en supporter les coûts afférents ou vous prive de mener votre propre procédure individuelle. Mais il vous est possible de sortir (out) en refusant de participer à cette procédure collective. Le plus souvent, ce refus s’exprime après le jugement statuant sur la responsabilité et sur l’indemnisation. Dans une procédure d’opt-in, le justiciable doit manifester son intention de participer à la procédure. Omar Kafi Cherrat, La réforme de l’action de groupe française, ou l’art de « couper la poire en deux », Gaz. Pal. 29 juillet 2025, n° 26 , p. 10 s. « La réforme de l’action de groupe est inaboutie en ce qu’elle ne touche pas à la question, ô combien importante, de la constitution du groupe. Dans la continuité du droit antérieur, la loi du 30 avril 2025 maintient la mise à l’écart du système d’option d’exclusion (opt-out) au profit d’un système d’option d’inclusion (opt-in) tardif. Ainsi, pour bénéficier des résultats de l’action de groupe, les personnes physiques ou morales remplissant les critères d’appartenance au groupe doivent réaliser une démarche positive pour y adhérer. Or, ce statut quo est regrettable. Dans le système d’opt-in, il est à craindre que seul un faible nombre de victimes effectue les démarches pour rejoindre l’action, notamment lorsque l’enjeu financier individuel est modique. Une telle situation pourrait fragiliser le potentiel normatif d’un mécanisme dont l’une des finalités essentielles est de dissuader la commission d’agissements illégaux ». La loi DDADUE « maintient la mise à l’écart du système d’option d’exclusion (opt-out) au profit d’un système d’option d’inclusion (opt-in) tardif. Ainsi, pour bénéficier des résultats de l’action de groupe, les personnes physiques ou morales remplissant les critères d’appartenance au groupe doivent réaliser une démarche positive pour y adhérer. (…) le système de l’opt-out – qui présume, sauf expression contraire de volonté, l’adhésion de toutes les victimes au groupe – a en réalité l’avantage de permettre la condamnation du défendeur à réparer l’intégralité du préjudice qu’il a occasionné »
[[12]]url:#_ftnref12 L’article 3-8°) définit la pratique comme « tout acte ou omission d’un professionnel ».
[[13]]url:#_ftnref13 C’est exactement l’opposé en droit américain. En effet, l’ « american rule » prévoit, sauf exceptions, que chaque partie supporte ses frais d’avocats. Cette règle vise notamment à ne pas dissuader les justiciables, y compris les plaignants aux revenus modestes, d’engager un recours par crainte d’avoir à payer en cas d’échec l'intégralité des frais du camp adverse https://www.justice.gov/archives/jm/civil-resource-manual-220-attorneys-fees Les détracteurs des class-actions expliquent le succès de cette procédure par le fait que l’initiateur, le plus souvent un avocat, ne prend pas de risque financier de lancer une telle action.
[[14]]url:#_ftnref14 Omar Kafi-Cherrat La transposition de la directive du 25 novembre 2020 sur les actions représentatives : la France à la croisée des chemins, JCP G 2023, n° 3 p. 170 et s.
[[15]]url:#_ftnref15 Comm. UE, recomm. 2013/396/UE, 11 juin 2013 relative à des principes communs applicables aux mécanismes de recours collectif en cessation et en réparation dans les États membres en cas de violation de droits conférés par le droit de l’Union : JOUE n° L 201, 26 juill. 2013, p. 60, COM (2018) 40 final. – V. not. L. Idot, Enfin l’action de groupe ? : Europe 2013, focus 38. Avis. Actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et des PME. Consultable : www.ccecrb.fgov.be/p/fr/1029/actions-representatives-visant-a-proteger-les-interets-collectifs-des-consommateurs-et-des-pme .
[[16]]url:#_ftnref16 Loi du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne (« DDADUE ») en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes, JO 2 mai 2025, texte n° 1, https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2025/4/30/ECOM2415026L/jo/texte .
[[17]]url:#_ftnref17 Rapport d'information de M. Charles Sitzenstuhl, au nom de la commission des affaires européennes de l’Assemblée nationale, n° 791, p. 38 https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/rapports/due/l17b0791_rapport-information.pdf
[[18]]url:#_ftnref18 Maria José Azar-Baud, Implementation of the Representative Actions Directive across the European Union: state of play, C.J.Q. 2025, 44(2), 124-149
BEUC (Etude des professeurs Peter Rott et al.) Comparative Legal Study on Procedural Rules and their Impact on Collective Redress Actions in Europe, https://www.beuc.eu/sites/default/files/publications/BEUC-X-2025-026_Study_Procedural_Rules_Impact_on_Collective_Redress_in_EU.pdf : « la directive a laissé de nombreux détails, et même des questions fondamentales sur les litiges collectifs, au pouvoir réglementaire des États membres, établissant ainsi une norme minimale qui est trop faible dans certains domaines cruciaux. Parmi ces domaines, cette étude se concentre sur trois questions clés (…) : les actions collectives visant à obtenir la réparation de dommages immatériels, les questions liées à la charge de la preuve et à la divulgation d'informations, et le financement des cas de recours collectif (…) Une analyse détaillée de la mise en œuvre de la directive (…) révèlent des différences significatives qui affectent le potentiel des actions de recours collectif. L'étude met en évidence les obstacles que les États membres ont créés ou n'ont pas réussi à éliminer, tout en soulignant les "meilleures pratiques" pour réglementer les questions susmentionnées ».
[[19]]url:#_ftnref19 Rapport d’information n° 791, p. 39
[[20]]url:#_ftnref20 https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/textes/l17b0529_projet-loi#
[[21]]url:#_ftnref21 Avis sur le projet de loi, n° 408 470, 24 octobre 2024, NOR : ECOM2415026L, https://www.conseil-etat.fr/content/download/220620/document/408470%20Extrait%20conforme%20AVIS%20(24.10.2024).pdf
[[22]]url:#_ftnref22 https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/textes/l17b0529_etude-impact.pdf
[[23]]url:#_ftnref23 Consommation et pratiques anticoncurrentielles, Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, dite « loi Hamon » , Santé, environnement, protection des données personnelles, discriminations au travail, « litiges administratifs », Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, publiée au Journal officiel du 19 novembre 2016, Location d’un bien immobilier Loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (dite « loi ELAN »), publiée au Journal officiel du 24 novembre 2018 – Cf. Annexe 2 sur les 7 régimes d’action de groupe. Dans leur avis (Sénat,, Avis n° 389 (2024-2025) au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d’administration générale sur le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes, présenté par Christophe-André Frassa, déposé le 4 mars 202, https://www.senat.fr/rap/a24-389/a24-389.html ), les sénateurs considèrent que cette diversité des régimes pourraient expliquer le « succès mitigé » de l’action de groupe en droit français (p. 22).
[[24]]url:#_ftnref24 La loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 dite « Loi Hamon »
[[25]]url:#_ftnref25 P. Gosselin et L. Vichnievsky : Rapp. AN n° 3085, 11 juin 2020, https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion_lois/l15b3085_rapport-information# Les têtes de chapitre du rapport permettent d’identifier les principales pistes de réforme : créer un régime général de l’action de groupe, élargir la qualité pour agir, garantir une meilleure indemnisation des victimes, garantir le financement des actions de groupe, réformer la procédure pour réduire les délais de jugement.
[[26]]url:#_ftnref26 La pratique sous la plume du cabinet Vogel & Vogel était beaucoup plus tranché en affirmant « l’échet des actions de groupe » https://www.vogel-vogel.com/lechec-des-actions-de-groupe-en-france-pourquoi/ . En dénonçant une véritable « usine à gaz », les praticiens constataient que les autres action étaient « autrement plus efficaces ». Ils dénonçaient une « action de groupe mal conçue », notamment en raison du « monopole des associations agréées qui exclut les avocats et prive l’action de groupe de tout dynamisme ». Dans cette analyse du printemps 2017, Vogel n’hésitait pas à conclure « L’action de groupe loi Hamon et ses avatars (l’action de groupe en matière de santé et de discriminations) tiennent plus de l’effet d’annonce que du droit réel, puisque la pratique a inventé des modes d’action beaucoup plus efficaces. On ne peut que s’en réjouir car cette loi, fondée sur la présomption de malveillance généralisée des professionnels, ne correspond absolument pas à la réalité. » C’est parce que nous partageons cette analyse que nous avons mis en place une plateforme (www.myleo.legal ) destinée à faciliter les actions collectives conjointes.
[[27]]url:#_ftnref27 Assemblée nationale, Rapport n° 631, op. cit., p. 95
[[28]]url:#_ftnref28 Vichnievsky -Gosselin, Proposition de loi pour un nouveau régime de l’action de groupe : Assemblée nationale, Rapp. n° 3329, 15 sept. 2020.
Vichnievsky -Gosselin, Proposition de loi relative au régime juridique des actions de groupe, Assemblée nationale, n° 639, 15 décembre 2022, https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/textes/l16b0639_proposition-loi# Marc Dupré, Veille, Actions de groupe, Responsabilité civile et assurances n° 3, Mars 2024, alerte 30
[[29]]url:#_ftnref29 Jérome Julien, La réforme de l’action de groupe est en cours : regard sur la proposition de loi, RDC Sept. 2023, n° 3, p. 64 et s.
[[30]]url:#_ftnref30 https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/textes/l16t0087_texte-adopte-seance#
[[31]]url:#_ftnref31 Dans son avis (n° 389, p. 9), la Commission des lois insiste sur « le risque réputationnel significatif qu’entraîne l’engagement d’une action de groupe et à l’instrumentalisation vraisemblable de cette procédure, qui détournerait les justiciables, à leur détriment, des voies de droit commun ». Ce procès d’intention sera évoqué dans la 3e partie afin d’en démontrer l’inconséquence et le caractère artificiel.
[[32]]url:#_ftnref32 https://www.senat.fr/rap/l23-271/l23-271.html
[[33]]url:#_ftnref33 https://www.senat.fr/leg/tas23-064.html - Dans le rapport de la Commission des lois, les sénateurs se montrent particulièrement sensibles sur deux sujets : d’une part, la qualité à agir et d’autre part l’amende civile.
Sur la qualité à agir, la proposition élargissait ce droit d’initier une action de groupe aux associations ad hoc « régulièrement déclarées agissant pour le compte soit d’au moins cinquante personnes physiques, soit d’au moins cinq personnes morales de droit privé inscrites au registre du commerce et des sociétés depuis au moins deux ans, soit d’au moins cinq collectivités territoriales ou groupements de collectivités se déclarant victimes d’un dommage causé par le défendeur ». La Commission des lois pointait du doigt le risque de « dérive d’une action de groupe banalisée » car les associations ad hoc n’offraient pas les mêmes « garanties de sérieux et de transparence » qu’une association agréée (Rapport, p. 9). On peut douter de cette pétition de principe qui reflète plus les a priori et les craintes qu’une réalité vérifiable. En effet, on peut penser que l’office du juge en charge de l’action de groupe devrait lui permettre de vérifier si l’action de groupe n’est pas instrumentalisée, par exemple, par un concurrent qui chercherait à déstabiliser une entreprise en finançant une association créée pour l’occasion. Enfin, la Commission estime « que la création d'une amende civile pour faute lucrative n'était pas consensuelle (sic !), que son introduction dans la présente proposition de loi n'était pas opportune et que le dispositif proposé était marqué par plusieurs fragilités juridiques » (Rapport, p. 82).Dès lors, la commission a supprimé purement et simplement l’article relatif à la création de cette sanction.
[[34]]url:#_ftnref34 Miren Lartigue, Actions de groupe : les sénateurs ont sensiblement modifié le texte, Gaz. Pal. 20 février 2024, n° 6, p. 5 et s.
[[35]]url:#_ftnref35 Rapport d’information n° 791, op. cit., p. 41
[[36]]url:#_ftnref36 https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/amendements/0529/CION_LOIS/CL18
[[37]]url:#_ftnref37 Sénat, Avis n° 389 (2024-2025) op. cit.
[[38]]url:#_ftnref38 CE, 6e-5e ch. réunies, 6 nov. 2024, no 490435 : Lebon T. Gaz. Pal. 11 février 2025, n° 5, p. 5 Note P. Hot et A. Berger
[[39]]url:#_ftnref39 En l’absence de codification de l’action de groupe, la numérotation parait « fastidieuse » (Rafael Amaro, op. cit.). Omar Kafi Cherrat précise que « Le législateur a exclu l’hypothèse d’une codification de ce texte, dans le prolongement de ce qui était prévu dans la proposition de loi. Le choix d’une loi non codifiée s’est imposé, à la suite de l’avis du Conseil d’État, car les règles relatives à l’action de groupe ont à la fois une nature procédurale marquée pour pouvoir intégrer le Code civil, et un caractère législatif, ce qui les empêche d’être logées dans le Code de procédure civile. Si les raisons de la non-codification du nouveau régime de l’action de groupe peuvent a priori s’entendre, on n’en éprouve pas moins un certain malaise à voir ces règles condensées dans un seul article dont la lisibilité de la numérotation et la clarté de la structure laissent à désirer » La réforme de l’action de groupe française, ou l’art de « couper la poire en deux ».
[[40]]url:#_ftnref40 C. Lèguevaques, Encore un effort pour doter la France d'une véritable « class action » efficace, LPA avril 2023, n° LPA202f1
[[41]]url:#_ftnref41 Benjamin Pouchoux. L’action de groupe en France après la loi “ DDADUE ” : les anciens régimes et la révolution. 2025. hal-05226387 https://hal.science/hal-05226387v1 - L’auteur, par ailleurs à l’origine d’une thèse remarquée (B. POUCHOUX, L’action collective des groupements privés en droit public français, Thèse. dactyl., Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 2020, 981 p), se montre particulièrement sévère tant sur la rédaction (« La lecture de cet article, ponctué de renvois incessants, prend alors l’allure d’une promenade interminable dans les dédales d’un bidonville labyrinthique qui se serait installé de façon sauvage en périphérie de la raison humaine ») que sur le fond (« Destiné à déverrouiller l’action de groupe en droit français, l’article 16 de la loi « DDADUE » n’est non seulement pas parvenu à la débarrasser de la plupart des défauts des anciens régimes spéciaux, mais a réussi à en ajouter de nouveaux »).
[[42]]url:#_ftnref42 B. Pouchoux, op. cit. n °12.
[[43]]url:#_ftnref43 CE, 9 nov. 2016, n° 393108, Bindjouli : JurisData n° 2016-024113 ; Lebon, p. 496, concl. J. Lessi. - CE, 9 nov. 2016, n° 393902, Faure - min. Aff. Soc., Santé et Droits de l'homme : JurisData n° 2016-023458 ; Lebon, T., p. 938, 941 et 950. - CE, 9 nov. 2016, n° 393926 , même requérant, inédit : Dr. adm. 2017, comm. 3 , n° 1, note C. Lantero ; JCP G 2017, 58 , note J.-C. Rotoullié ; RDP 2017, p. 1581, note N. Sild ; AJDA 2017, p. 426 , note S. Brimo). « La responsabilité de l'État peut être engagée à raison de la faute commise par les autorités agissant en son nom dans l'exercice de leurs pouvoirs de police sanitaire relative aux médicaments, pour autant qu'il en soit résulté un préjudice direct et certain ».
[[44]]url:#_ftnref44 CAA Paris, 4 avr. 2025, n° 23PA05049 : Resp. civ. et assur. 2025, repère 6 – V. également les conclusions du rapporteur public Gaëlle Degardin, JCP / La Semaine Juridique – éd° Adm. & coll. Terr., n° 29. 21 juillet 2025, p. 33
[[45]]url:#_ftnref45 B. Pouchoux, op. cit. n °15, L’article 16-I-B « revient donc à neutraliser l’action de groupe lorsqu’elle vise un manquement à des dispositions du code de la santé qui ne sont pas imputables à ces catégories de personnes »
[[46]]url:#_ftnref46 S. Robin-Olivier, R. Beauchard et D. de la Garanderie, La responsabilité sociale de l’entreprise (RSE), Rev. Dr. du trav. 2011, p. 395 et s – Pièce n° 164
[[47]]url:#_ftnref47 E. DAOUD et J. FERRARI, La RSE sociale : de l’engagement volontaire à l’obligation juridique , JCP (E) 25 septembre 2012, n° 39, Doctrine n° 1391, p. 13 et s.
[[48]]url:#_ftnref48 F.-G. TREBULLE, Rép. Sociétés, Dalloz, V° Responsabilité sociale des entreprises, mars 2003 (multiples mises à jour)
[[49]]url:#_ftnref49 G. Viney et P. Jourdan, Traité de droit civil. Les conditions de la responsabilité : LGDJ, 2' éd. 1998, 11 ° 461, p. 346.
[[50]]url:#_ftnref50 Cour suprême des États Unis d'Amérique, 26 juin 2003, Nike Inc. e.a., Petitioners cl Marc Ka sky, 45 P. 3d 243, 301. Cal. Sup. Ct 2002.. Renaud Beauchard, op. cit. « En 1993, Nike fit signer à ses sous-traitants un « memorandum of understanding », leur demandant de respecter certaines règles essentielles en matière sociale : interdiction du travail des enfants, respect des règles locales en matière de salaire minimum, horaire hebdomadaire maximum, vacances et assurances sociales obligatoires, conditions de travail décentes etc. Critiquée par des activistes, Nike avait commandé un rapport favorable à une icône de la lutte pour les droits civils Andrew Young, ex-ambassadeur des États-Unis aux Nations unies, ancien maire d'Atlanta (…) Plusieurs associations ont alors entamé une virulente campagne, alléguant que le rapport Young était de pure complaisance. En avril 1998, un activiste californien, Marc Kasky, porta l'affaire devant les tribunaux alléguant d'actes de concurrence déloyale et de publicité mensongère sur le fondement des dispositions du code californien des affaires et des professions (Business and Profession Code). Kasky n'invoquait aucun dommage personnel et direct mais agissait au nom du public de l'État de Californie et « on information and belief », c'est-à-dire au nom du droit de ce même public de se former une opinion fondée sur une représentation exacte de la réalité. Il alléguait que Nike avait omis de divulguer certaines informations ou avait communiqué des informations erronées relatives aux conditions de travail des travailleurs employés par ses sous-traitants, afin de garantir ou maintenir ses ventes. (…) »
[[51]]url:#_ftnref51 La compliance regroupe l’ensemble des processus destinés à assurer qu’une entreprise, ses dirigeants et ses salariés respectent les normes juridiques et éthiques qui leur sont applicables.
[[52]]url:#_ftnref52 L. n° 2017-399, 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre : JO 28 mars 2017, texte n° 1 ; JCP E 2017, act. 250 ; JCP E 2017, 1193.
[[53]]url:#_ftnref53 L. n° 2016-1691, 9 déc. 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique : JO 10 déc. 2016, texte n° 2 ; JCP E 2016, act. 1008.
[[54]]url:#_ftnref54 Sur cette question importante et complexe, on peut notamment prendre connaissance de la Résolution du Parlement européen du 13 septembre 2022 contenant des recommandations à la Commission sur le financement privé responsable du règlement de contentieux (2020/2130(INL) https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0308_FR.pdf . Ainsi le Parlement européen « demande à la Commission de suivre et d’analyser de près l’évolution du financement des contentieux par des tiers dans les États membres, tant du point de vue du cadre que de la pratique juridiques, en accordant une attention particulière à la mise en œuvre de la directive (UE) 2020/1828; demande en outre à la Commission, (…) compte tenu des effets de cette directive, de présenter, sur la base de l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, une proposition de directive établissant des normes minimales communes au niveau de l’Union concernant le financement commercial des contentieux par des tiers, conformément aux recommandations qui figurent en annexe ».
On pourra lire également l’étude très complète Gustavo Cerqueira et Marina Teller (sous la dir.), Le retour du financement de contentieux par les tiers : la marche vers la privatisation de la justice ? Revue internationale de droit économique 2024/2 t. XXXVIII.
Le CNB et le barreau de Paris ont pris diverses résolution afin de faciliter le recours à ce type de financement tout en rappelant aux avocats l’impératif de respecter les règles déontologiques
[[55]]url:#_ftnref55 Club des juristes, Financement du procès par les tiers, Juin 2014, p. 23.
[[56]]url:#_ftnref56 Beaumarchais « Le barbier de Séville, II-8, « La calomnie, Monsieur ? Vous ne savez guère ce que vous dédaignez ; j’ai vu les plus honnêtes gens prêts d’en être accablés. Croyez qu’il n’y a pas de plate méchanceté, pas d’horreurs, pas de conte absurde, qu’on ne fasse adopter aux oisifs d’une grande ville, en s’y prenant bien : et nous avons ici des gens d’une adresse ! ... D’abord un bruit léger, rasant le sol comme hirondelle avant l’orage, pianissimo murmure et file, et sème en courant le trait empoisonné. Telle bouche le recueille, et piano, piano vous le glisse en l’oreille adroitement. Le mal est fait, il germe, il rampe, il chemine, et rinforzando de bouche en bouche il va le diable ; puis tout à coup, ne sais comment, vous voyez calomnie se dresser, siffler, s’enfler, grandir à vue d’œil ; elle s’élance, étend son vol, tourbillonne, enveloppe, arrache, entraîne, éclate et tonne, et devient, grâce au Ciel, un cri général, un crescendo public, un chorus universel de haine et de proscription. Qui diable y résisterait ? »
[[57]]url:#_ftnref57 Avis n° 406 517 du 9 février 2023 sur une proposition de loi relative au régime juridique des actions de groupe, https://www.conseil-etat.fr/avis-consultatifs/derniers-avis-rendus/a-l-assemblee-nationale-et-au-senat/avis-sur-une-proposition-de-loi-relative-au-regime-juridique-des-actions-de-groupe
[[58]]url:#_ftnref58 Bruno Deffains, Myriam Donat-Duban, Eric Langlais, économie des actions collectives, Puf « Droit & Justice », 1995, p. 29 et s. « parmi les objectifs d’un recours collectif, on peut également avancer la dissuasion de comportement risques en imposant des sanction. Il s’agit là de la question au cœur de l’efficacité des actions collectives comme instrument de lutte contre des activités pouvant entrainer des préjudices collectifs nombreux et importants ».
[[59]]url:#_ftnref59 « 23. [Le Conseil d’Etat] constate, par ailleurs, que cette sanction s’analyse, au regard de la jurisprudence constitutionnelle et conventionnelle, comme une « sanction ayant le caractère d’une punition ». Elle doit, en conséquence, satisfaire à la triple exigence de nécessité, de proportionnalité et de légalité. »
[[60]]url:#_ftnref60 Dans une class action américaine, les dommages et intérêts punitifs (« punitive damages ») sont principalement attribués aux membres du groupe (la « class ») qui ont subi le préjudice. Le montant accordé par le tribunal (le plus souvent en présence d’un jury), qui inclut à la fois les dommages compensatoires (pour réparer le préjudice subi) et les dommages punitifs (pour sanctionner le comportement fautif), est réparti entre tous les membres du groupe ayant participé à l’action et reconnu leur qualité de victime. Marc Lipskier, Les entreprises peuvent-elles profiter de l'introduction des class actions en droit français ? La Semaine Juridique Entreprise et Affaires n° 18-19, 5 mai 2005, 675 – Institut national de la consommation (INC), L’action de groupe vers une consécration ?, INC Hebdo n° 1349, 27 juin – 3 juillet 2005, p. II, https://www.inc-conso.fr/sites/default/files/pdf_abonne/1349-action_groupe2__257.pdf - M. Mercier, « Les class actions, du droit américain au droit européen », 2012, Larcier ; F. Laroche-Gisserot, « Les class actions américaines », LPA 10 juin 2005, p. 7 .
[[61]]url:#_ftnref61 Devenu l’un des piliers du droit des fiducies en common law, le terme « cy-près » trouve son origine dans les allocutions françaises « ici près » ou « aussi près », cette dernière interprétation semble avoir retenu les faveurs de la common law, le terme « cy-près » étant défini comme « as near as possible»( JH BAKER, Manual of law French, 2ème éd. Aldershot Hants, Scolar Press, 1990).
La Cy près doctrine est issue de la tradition juridique anglaise. Cette règle jurisprudentielle très ancienne permet aux tribunaux de modifier de façon discrétionnaire les termes d’un trust d’utilité publique ou d’un testament, lorsque la volonté initiale du constituant ou du testataire est devenue impossible à réaliser. L’essentiel étant de demeurer au plus près de cette dernière.
Aux Etats-Unis et au Canada, l’application de la cy-près doctrine dans la conclusion règlements des class action est devenue monnaie courante. C’est la Cour de Californie qui en 1986 qui a reconnu l’utilisation du cy pres dans le cadre du règlement des class action. Cette jurisprudence fut ensuite étendue à d’autres cours. Initialement, l’argent restant devait être distribué à un autre ensemble de consommateurs qui peuvent ou non coïncider avec le groupe de demandeurs. Par le biais de la cy pres doctrine, il est admis que les dommages et intérêts restants soient affectés à un organisme de bienfaisance ou d’intérêt public. Le recours au mécanisme du cy pres est apparu comme la meilleure alternative à plusieurs égards : (i) afin de ne pas rendre les fonds non-demandés au défendeur et ainsi combler le fossé qui pouvait séparer le constat de responsabilité et la répartition des dommages dans un procès. (ii) afin de surpasser les difficultés d’indemnisation liées à la faible teneur de ces dernières (iii) afin de permettre une réparation intégrale du préjudice réel. En droit américain, il est admis qu’en exigeant des défendeurs qu’ils versent un règlement qui ne s’adresse pas aux membres du groupe, les ordonnances cy pres renforcent la fonction dissuasive des recours collectifs.
Des critères détaillés ont été déterminés par la jurisprudence concernant les organisations attributaires : (i) L’organisation doit avoir la capacité de fournir un réel avantage aux membres du groupe concernées par la class action ; (ii) Il faut que ce soit une organisation à but non lucratif ; (iii) Elle doit démontrer d’une stabilité financière ; (iv) Elle doit démontrer sa capacité de pouvoir agir sur tout le territoire ; (v) Elle doit démontrer sa capacité d’atteindre plusieurs cibles : adultes, enfants, personnes âgées …
[[62]]url:#_ftnref62 https://observatoireactionsdegroupe.com/
[[63]]url:#_ftnref63 Décret n° 2025-734 du 30 juillet 2025 relatif à la procédure applicable aux actions de groupe et au registre des actions de groupe NOR : JUSC2517330D, JORF n°0177 du 1 août 2025, texte n° 6 - https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2025/7/30/JUSC2517330D/jo/texte
[[64]]url:#_ftnref64 A savoir les départements et régions de la Guadeloupe et de la Réunion, des collectivités uniques de Guyane et de Martinique depuis décembre 2015 et, depuis mars 2011 du département de Mayotte
[[65]]url:#_ftnref65 Certains pourraient voir dans ce contrôle accru de l’Etat sur l’activité des associations une mesure restrictive du droit d’action des associations. Voir notamment Antonio Delfini et Julien Talpin, L’Etat contre les associations : anatomie d’un tournant autoritaire, Textuel « Petite cncyclopédie critique », 2025, p. 12 « Comprendre ce qui arrive aux associations suppose de réinscrire cette dynamique dans le cadre plus large de la poussée autoritaire qu’a connu notre pays au cours de la décennie écoulée (…) Face à ces mobilisation, la réponse de l’Etat s’est faite de plus en plus dure : violences policières, gardes à vue et interdictions de manifestations, délits d’apologie du terrorisme, dissolution d’associations, coupes de subventions. L’Etat bâillonne ses contre-pouvoirs. »
[[66]]url:#_ftnref66 La loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République entend renforcer le contrôle de l’État sur les associations. À cette fin, le texte fait en particulier peser ces dernières une obligation supplémentaire, à savoir le respect des principes contenus dans le contrat d’engagement républicain qu’elle institue : principes de liberté, d’égalité, de fraternité et de dignité de la personne humaine, ainsi que les symboles de la République ; non-remise en cause du caractère laïque de la République ; abstention de toute action portant atteinte à l’ordre public. L’engagement à respecter les principes contenus dans le contrat d’engagement républicain est en particulier nécessaire pour pouvoir bénéficier de subventions publiques. Mais le texte ajoute que cette obligation est réputée satisfaite par les associations agréées ainsi que par les associations reconnues d’utilité publique. C’est dire que l’agrément vaut présomption simple de respect des principes contenus dans le contrat d’engagement républicain. L. n° 2021-1109 du 24 août 2021, art. 12 ; L. n° 2000-321 du 40.12 avr. 2000, art. 10-1 nouv.
[[67]]url:#_ftnref67 Articles L141-1 à L141-2 et R141-1 à R141-20 du code de l’environnement
- Décret n°2011-832 du 12 juillet 2011 relatif à la réforme de l’agrément au titre de la protection de l’environnement et à la désignation des associations agréées, organismes et fondations reconnues d’utilité publique au sein de certaines instances
- Arrêté du 12 juillet 2011 relatif à la composition du dossier de demande d’agrément
[[68]]url:#_ftnref68 Julien J., Droit de la consommation, nov. 2022, Lextenso, 9782275125268, n° 487 et s.
[[69]]url:#_ftnref69 Par renvoi à l’article 811-1 du Code de la consommation et à l’arrêté du 21 juin 1988 relatif à l'agrément des organisations de défense de consommateurs, NOR : ECOC8800066A https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006074995/ quinze associations sont identifiés. On peut retrouver la liste et les coordonnées https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/les-demarches-et-les-services/en-tant-que-consommateur/liste-et-coordonnees-des-associations . Par ailleurs, l’INC les a classées par domaine d’intervention (alimentation, énergie, logement, finances, santé, NTIC, transports, etc.) : https://www.inc-conso.fr/sites/default/files/pdf/associations-consommateurs-principaux-domaines-intervention-2023_0.pdf
[[70]]url:#_ftnref70 Cass. 1re civ., 25 mars 2010 : Bull. civ. I, n° 76 ; Contrats, conc. consom. 2010, comm. 169, note Raymond ; D. 2010, act. jurispr. p. 886, obs. Delpech et jur. p. 1842, note Dupont ; JCP G 2010, act. n° 374, obs. Corgas-Bernard ; JCP E 2010, n° 1722, note Rodriguez ; JurisData n° 2010-002531 ; RDC 2010, p. 879, note Fenouillet ; Rev. Lamy dr. aff. 2010/49, n° 2872, p. 46, obs. Anadon ; RTD com. 2010, p. 599, obs. Bouloc. ■ CA Angers, 17 mai 2011 : Contrats, conc. consom. 2011, comm. 202, note Raymond ; JurisData n° 2011-010704
Le JurisClasseur Civil Annexes Fasc. 15 : ASSOCIATIONS, § 112 cite une jurisprudence amusante : L’action en cessation d’agissements illicites des articles L. 621-7 et L. 621-8 du Code de la consommation a donné lieu à un jugement du TGI de Paris le 9 février 2017 ( TGI Paris, 9 févr. 2017, n° 15/07813 ) saisi d’une telle action par une association agréée au titre des associations de consommateurs exercée contre une société éditrice d’un site de rencontre dont la communication faisait la promotion de l’infidélité. Selon l’association, l’agissement illicite est constitué par la référence à l’infidélité dans le cadre d’une publicité. Le TGI déclare l’association irrecevable en son action aux motifs que la référence à l’infidélité dans les supports publicitaires de la société ne peut être considérée comme un agissement illicite dès lors que le manquement au devoir de fidélité qui ressort de l’ordre public de protection (et non de direction) n’est pas nécessairement constitutif d’une faute cause de divorce, soit parce que les époux se sont déliés d’un commun accord de ce devoir, soit parce que l’infidélité d’un époux peut être excusée par le comportement de l’autre.
[[71]]url:#_ftnref71 Pour mémoire, au sens des articles L. 2122-1, L. 2122-5 ou L. 2122-9 du code du travail ou de l’article L. 221-1 du code général de la fonction publique, les syndicats représentatifs au niveau national et interprofessionnel sont : la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ; la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC). la Confédération générale du travail (CGT) ; Force ouvrière (FO) ; la Confédération française de l’encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC).
[[72]]url:#_ftnref72 Pour mémoire et en application de l’article 27 de la loi organique n° 2016-1090 du 8 août 2016 (JORF n° 0186 du 11 août 2016, https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000033011065 ), ce sont l’Union syndicale des magistrats (USM), le syndicat de la magistrature (SM) et Unité magistrats-FO
[[73]]url:#_ftnref73 Selon l'article L. 1251-59 du Code du travail, les organisations syndicales représentatives peuvent exercer en justice en faveur d'un salarié, sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé, toutes les actions résultant de l'application du chapitre du Code du travail relatif au contrat conclu avec une entreprise de travail temporaire. Le salarié est averti par lettre recommandée et ne doit pas s'y être opposé dans un délai de 15 jours. La lettre recommandée adressée au salarié par le syndicat indique la nature et l'objet de l’action , ainsi que les droits du salarié. Le syndicat doit avoir averti chaque salarié concerné avant d'engager l' action de substitution, au plus tard le jour de l'introduction de l'instance, aucune régularisation ultérieure n'étant admise. Cass. soc., 23 oct. 2024, n° 23-11.087, FS-B - La Semaine Juridique Social n° 43-44, 29 octobre 2024, act. 691
Le salarié peut, à tout moment, intervenir pour assurer individuellement la défense de ses intérêts ou mettre un terme à l’action (Cons. Const., 25 juillet 1989, n°89-549 DC)
[[74]]url:#_ftnref74 L’action exercée par les syndicats dans l' intérêt collectif de la profession a fait l'objet d'une jurisprudence abondante, sans qu'il soit aisé d'en dessiner les contours. Au cours des dernières années, la Cour de cassation a adopté une lecture extensive, élargissant la portée du dispositif et allant jusqu'à admettre de prononcer la régularisation de droits individuels. Dans deux décisions récentes, la Cour de cassation retient une position plus rigoureuse et rappelle qu'il convient de distinguer les demandes qui relèvent de l’action syndicale et celles qui relèvent de l’action individuelle des salariés. « L'action exercée par les syndicats dans l'intérêt collectif de la profession » - Etude par Bryan Keddouri et Arnaud Teissier La Semaine Juridique Social n° 8, 28 février 2023, 1051
L’action d’un syndicat dans l’intérêt collectif de la profession ne peut être utilisée pour rétablir les salariés dans leurs droits individuels notamment aux fins d’obtention d’une compensation financière au titre de jours de repos dont ils ont été privés au regard de la réglementation sur la durée du travail. Cass. soc., 20 avr. 2023, n° 23-40.003, FS-B, QPC, Synd. national des pilotes de ligne France Alpa c/ SAS Alljet : JurisData n° 2023-006161. Procédures n° 7, Juillet 2023, comm. 215 Note Alexis Bugada.
Selon l'article L. 1251-59 du Code du travail, les organisations syndicales représentatives peuvent exercer en justice en faveur d'un salarié, sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé, toutes les actions résultant de l'application du chapitre du Code du travail relatif au contrat conclu avec une entreprise de travail temporaire. Le salarié est averti par lettre recommandée et ne doit pas s'y être opposé dans un délai de 15 jours. La lettre recommandée adressée au salarié par le syndicat indique la nature et l'objet de l’action , ainsi que les droits du salarié. Le syndicat doit avoir averti chaque salarié concerné avant d'engager l’action de substitution , au plus tard le jour de l'introduction de l'instance, aucune régularisation ultérieure n'étant admise. Cass. soc., 23 oct. 2024, n° 23-11.087, FS-B - La Semaine Juridique Social n° 43-44, 29 octobre 2024, act. 691
Pas de demande de régularisation de la situation individuelle des salariés sous couvert d'une action en défense des intérêts collectifs de la profession Cass. soc., 6 nov. 2024, n° 22-17.106, FS-B : JurisData n° 2024-019690 Commentaire par Jean-Yves Kerbourc'h, La Semaine Juridique Social n° 51-52, 24 décembre 2024, 1404
Si un syndicat peut agir en justice au titre de la défense des intérêts collectifs de la profession, il ne peut prétendre faire condamner l'employeur à régulariser la situation individuelle des salariés concernés. Une telle action relève de la liberté personnelle de chaque salarié de conduire la défense de ses intérêts. Cass. soc., 22 janv. 2025, n° 23-17.782, F-B : JurisData n° 2025-000410 Procédures n° 3, Mars 2025, comm. 58 Note Alexis Bugada
Ces régularisations et/ou réparations individuelles supposent donc l’exercice d’une action en justice par chacun des salariés concernés et l’action du syndicat ne suspend pas la prescription s’agissant des droits individuels (par ex., Soc. 6 nov. 2024, n°23-16.632)
[[75]]url:#_ftnref75 Article 1er de l’Arrêté du 19 juillet 2019 fixant la liste des organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles habilitées à siéger au sein des commissions, comités ou organismes à caractère national mentionnés au I de l'article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole, JORF n° 0172 du 26 juillet 2019, texte n° 77, https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000038822092/ « La liste des organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles habilitées à siéger au sein des commissions, comités ou organismes à caractère national mentionnés au I de l'article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 susvisée est fixée comme suit : Confédération paysanne ; Coordination rurale ; Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles ; Jeunes agriculteurs. »
[[76]]url:#_ftnref76 Rafael Amaro, Recours collectifs : premiers regards sur la transposition minimaliste de la directive 2020/1828, RPDA avril 2025, n° RDA100l8. Il se montre particulièrement critique : « De toute évidence, ce remaniement de l’action de groupe ne brille pas par ses innovations. Dans la mesure où le système antérieur ne fonctionnait pas, on peine à voir en quoi cette réforme pourrait avoir des conséquences notables. L’augmentation du nombre d’associations de consommateurs titulaires du droit d’agir ne devraient pas fondamentalement changer la donne. Dans la mesure où les principales associations agréées au niveau national éprouvaient déjà les plus grandes difficultés à s’emparer de cette action, il est probable que des associations moins bien dotées ne puissent faire mieux ». Cette analyse nous parait irréfutable.
[[77]]url:#_ftnref77 https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion_lois/l15b3085_rapport-information#_Toc256000023
[[78]]url:#_ftnref78 https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b3329_proposition-loi#
[[79]]url:#_ftnref79 https://www.senat.fr/rap/l23-271/l23-2717.html#toc66 « La commission n'a pas retenu le dispositif proposé, jugeant excessive l'ouverture de la qualité pour agir à laquelle il procède ». La commission justifie son opposition de principe en précisant qu’en « ouvrant très largement l'action à des acteurs dont la crédibilité et la sincérité ne pourront être diligemment vérifiées, les conditions ainsi prévues de la qualité pour agir pourraient conduire à l'engagement de procédures d'actions de groupe malveillantes, visant à faire porter un coût réputationnel lourd à des acteurs économiques dont tous n'auront pas les moyens financiers et juridiques de se défendre ». Par ailleurs, la commission des lois ajoute « il est impératif que les associations exerçant des actions de groupe présentent, au regard de l'importance des intérêts qu'elles représentent, de la sensibilité des données personnelles qu'elles sont amenées à recueillir ainsi que des aspirations dont elles se feront le relais, toutes les garanties de sérieux nécessaires pour mener à bien ces procédures de bout en bout. En la matière, décevoir les espoirs légitimes de personnes ayant subi des préjudices en accordant à des personnes incapables de conduire à leur terme de telles procédures pourrait in fine nuire à la crédibilité de l'action de groupe ». Enfin, toujours dans le souci apparent de protéger les consommateurs, la Commission indique que « le choix de l'ouverture large du prétoire déportera nécessairement la responsabilité de la vérification du respect, par les personnes arguant de leur qualité pour agir, de nécessaires exigences de transparence et de probité, d'autorités administratives - aujourd'hui responsables de la délivrance d'agréments - vers les juridictions ».
[[80]]url:#_ftnref80 https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/rapports/529/l17b1198_rapport-fond.pdf
[[81]]url:#_ftnref81 Entre dans cette catégorie, la Ligue des droits de l’homme (LDH)
[[82]]url:#_ftnref82 Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données – Article 82-« (1) Toute personne ayant subi un dommage matériel ou moral du fait d'une violation du présent règlement a le droit d'obtenir du responsable du traitement ou du sous-traitant réparation du préjudice subi (…) (6) Les actions judiciaires engagées pour exercer le droit à obtenir réparation sont intentées devant les juridictions compétentes en vertu du droit de l'État membre visé à l'article 79, paragraphe 2. ».
[[83]]url:#_ftnref83 Règlement (UE) 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité (JOUE, 5 juin 2015, L 141/19) et Règlement du 15 décembre 2021 portant modification du règlement (UE) 2015/848 relatif aux procédures d’insolvabilité afin de remplacer ses annexes A et B (JOUE du 20 décembre 2021, L455/4)
[[84]]url:#_ftnref84 Assemblée nationale, Rapport n° 631, op. cit., p. 109
[[85]]url:#_ftnref85 Omar Kafi Cherrat, La réforme de l’action de groupe française, ou l’art de « couper la poire en deux », Gaz. Pal. 29 juillet 2025, n° 26 , p. 10 s.
[[86]]url:#_ftnref86 Laurent Bloch, Affaire de la Dépakine : le tribunal judiciaire de Paris donne son feu vert à l'action de groupe (TJ Paris, 5 janv. 2022, n° 17/07001), Responsabilité civile et assurances n° 2, Février 2022, repère 2
[[87]]url:#_ftnref87 Omar Kafi Cherrat, op. cit. p. 10
[[88]]url:#_ftnref88 Entente
[[89]]url:#_ftnref89 Abus de position dominante
[[90]]url:#_ftnref90 Rafael Amaro, Recours collectifs : premiers regards sur la transposition minimaliste de la directive 2020/1828, RPDA avril 2025, n° RDA100l8 : « C’est aussi une action qui doit nécessairement être « follow-on », c’est-à dire consécutive à une décision définitive d’une autorité de concurrence ou de ses juridictions de contrôle qui constate le manquement au droit de la concurrence constitutif du fait générateur de responsabilité ».
[[91]]url:#_ftnref91 Nous reprenons le libellé exact de l’article bien que cette présentation ne soit pas heureuse. L’inversion des références ne facilite pas la lecture du texte.
[[92]]url:#_ftnref92 Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II de la loi no 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative,
[[93]]url:#_ftnref93 https://www.conseil-etat.fr/Media/contenu-froid/documents/actions_collectives/ag-20250418
[[94]]url:#_ftnref94 https://www.conseil-etat.fr/vos-demarches/je-suis-un-particulier/actions-collectives
[[95]]url:#_ftnref95 William P. Barnette, There Is No Conservative Case for Class Actions, Federalist Society Review, 13 juillet 2021. Federalist Society for Law and Public Policy Studies, le plus souvent appelée la Federalist Society, est une organisation américaine de droite conservatrice qui préconise une interprétation rigoriste et originaliste de la Constitution des États-Unis [Wikipedia] Financée par CHEVRON et les frères KOCH, elle est présentée comme « l'une des organisations juridiques les plus influentes de l'histoire - non seulement pour façonner la pensée des étudiants en droit, mais également pour changer la société américaine elle-même en déplaçant délibérément et avec diligence le système judiciaire du pays vers la droite » https://www.politico.com/magazine/story/2018/08/27/federalist-society-yale-history-conservative-law-court-219608 / . On considère que six des neufs membres de la Cour suprême en exercice sont des membres actuels ou anciens de cette organisation. Contra Maria-José Azar-Baud and Véronique Magnier, Class action à la française, p. 271, in Brian T. Fitzpatrick and Randall S. Thomas (edited by), The Cambridge Handbook of Class Actions, An International Survey, Cambridge university press, 2021, les deux auteurs s’inscrivent en faux sur le fait que les actions de groupe encourageraient une « société litigieuse ». Selon elles, il existe « des moyens d'améliorer le système afin de dissuader le professionnel d'enfreindre la loi, de l'encourager à la respecter, ainsi que des moyens de développer des méthodes alternatives de résolution des litiges de masse ».
[[96]]url:#_ftnref96 Articles 122 à 126 du Code de procédure civile : défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
[[97]]url:#_ftnref97 « même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
[[98]]url:#_ftnref98 Assemblée nationale, Rapport n° 631, op.cit. p. 100.
[[99]]url:#_ftnref99 Azra-Baud et Magnier, op. cit. « Dans l'Angleterre médiévale, la première action représentative n'a connu le succès qu'après 200 ans * Aux États-Unis165 et au Canada, en particulier au Québec, des réformes ont été nécessaires avant que le système ne soit compris et pratiqué régulièrement (…) le législateur européen n'est pas allé aussi loin que prévu ; ainsi, la maturation du modèle européen est loin d'être achevée. (…) Les actions collectives représentent une nouvelle opportunité pour les victimes, un nouvel outil pour les associations, une nouvelle pratique pour les avocats et les juges, une nouvelle façon de vivre en société et d'entreprendre de manière éthique. Ce mécanisme semble être en cours de développement et nécessite du temps. Néanmoins, des pistes d'amélioration ont été proposées, qui n'ont de sens que si elles sont considérées dans leur ensemble (…) Enfin de compte, rendre les actions collectives efficaces et efficientes en tant que mécanisme judiciaire conduirait à une utilisation plus importante. »
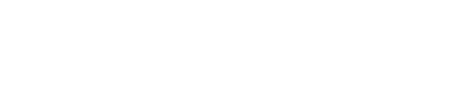
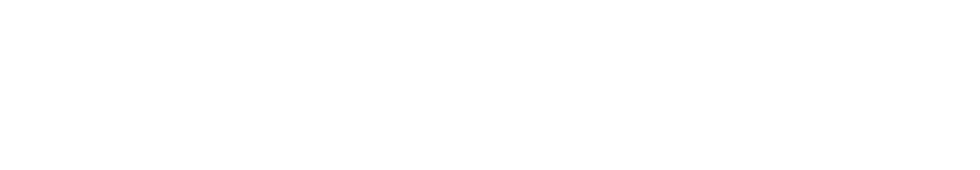

 Un avocat ?
Un avocat ?