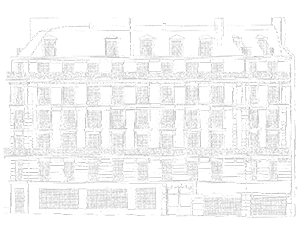Durant le week-end, Sabrina Cajoly, m'a communiqué un document riche d'enseignements.
J’aurai voulu vous communiquer les « Lignes directrices relatives à l’accès à la justice et à des voies de recours utiles dans le contexte des affaires ayant trait à des substances toxiques » qui seront étudiées par le conseil des droits de l’homme de l’ONU le 3 octobre 2025.
Mais, j’ai reçu ce document trop tard, donc je ne peux plus vous le communiquer.
Alors permettez moi d’en faire lire quelques extraits éclairants et qui permettront de fortifier votre décision de réformer l’ordonnance de non-lieu et d’ordonner une nouvelle instruction.
2. Pour des millions de personnes dans le monde, l’exposition à des substances toxiques est synonyme de peur, d’anxiété et d’angoisse, de maladie, de handicap ou de mort prématurée et douloureuse. Or, dans leur quête de justice et de réparation, les victimes se heurtent souvent à de lourds obstacles qui entraînent des retards dans les procédures et le déni de leurs droits. Des entraves telles que
- une charge de la preuve déraisonnable,
- des délais de prescription inadéquats et
- des obstacles financiers
entretiennent l’impunité, exacerbent les injustices environnementales et sapent les fonctions préventives, réparatrices et compensatoires des systèmes juridiques. Toutes ces entraves aggravent les violations des droits de l’homme qui résultent de l’exposition à des substances toxiques.
Elle s’est également penchée sur la question du droit à un procès équitable dans les affaires ayant trait à des substances dangereuses et sur celle de l’accès à la justice. À titre d’exemple, dans une affaire relative à l’amiante dans laquelle le délai de prescription était mis en question, la Cour a fait observer que, bien qu’il soit légitime de fixer un délai de prescription de dix ans pour assurer la sécurité juridique, il n’y avait pas de période de latence maximale scientifiquement reconnue entre l’exposition à l’amiante et le mésothéliome pleural malin (cancer de la plèvre)15. La Cour a estimé qu’interdire aux personnes souffrant de maladies qui n’ont pu être diagnostiquées que de nombreuses années après l’exposition de présenter des demandes d’indemnisation revenait à les priver de la possibilité de faire valoir leurs droits devant les tribunaux (Jann-Zwicker and Jann v. Suisse, requête no 4976/20, arrêt du 13 février 2024.)
Pollution héritée du passé
97. En 2025, la Haute Cour de justice d’Angleterre et du Pays de Galles a statué que les plaintes déposées par les communautés Bille et Ogale du Nigeria contre Shell pour la pollution par les hydrocarbures héritée du passé étaient recevables, même si les écoulements s’étaient produits des années auparavant, en ce que les faits allégués pouvaient constituer une infraction continue au regard des obligations juridiques de Shell.
La Cour a estimé que chaque jour où les hydrocarbures resteraient sur le terrain d’un demandeur créerait un nouvel intérêt à agir, ce qui signifie en substance que les pollueurs ne peuvent pas invoquer la prescription pour se soustraire à leurs obligations relatives à une pollution héritée du passé.
83. En 2023, la Cour interaméricaine des droits de l’homme a rendu son arrêt dans l’affaire Inhabitants of La Oroya v. Peru. Elle a estimé, au regard du droit à la santé, qu’il n’est pas nécessaire de prouver un lien de causalité direct entre les maladies contractées par les victimes et l’exposition de ces personnes à des polluants lorsque les éléments de preuve disponibles permettent d’établir que : certains polluants présentent un risque significatif pour la santé humaine.
84. De même, en 2025, la Cour européenne des droits de l’homme a rendu son arrêt dans l’affaire Cannavacciuolo et autres c. Italie, concernant la pollution d’une zone considérable causée par l’incinération et le déversement illégaux de déchets.
La Cour a estimé, au regard du droit à la vie, que les preuves de pollution et du fait que les requérants résidaient dans une zone touchée pendant une période considérable permettaient d’établir l’existence d’un risque grave, véritable et imminent pour la vie, et que les autorités avaient donc l’obligation d’agir.
Elle n’a pas jugé nécessaire ou approprié d’exiger des requérants qu’ils démontrent un lien avéré entre l’exposition à un type identifiable de pollution ou même à une substance nocive et l’apparition d’une maladie précise mettant la vie en danger ou le décès des suites de cette maladie96.
85. Une autre innovation est le renversement de la charge de la preuve. Dans l’affaire Vellore Citizens Welfare Forum v. Union of India and Others (1996), concernant la défense de l’intérêt général et la pollution de sources d’eau, la Cour suprême de l’Inde a estimé que la charge de la preuve incombait au promoteur, qui devait démontrer que ses activités n’avaient pas d’incidence grave sur l’environnement.
J’aurai voulu vous communiquer les « Lignes directrices relatives à l’accès à la justice et à des voies de recours utiles dans le contexte des affaires ayant trait à des substances toxiques » qui seront étudiées par le conseil des droits de l’homme de l’ONU le 3 octobre 2025.
Mais, j’ai reçu ce document trop tard, donc je ne peux plus vous le communiquer.
Alors permettez moi d’en faire lire quelques extraits éclairants et qui permettront de fortifier votre décision de réformer l’ordonnance de non-lieu et d’ordonner une nouvelle instruction.
Extrait n° 1 – Introduction
1. Le non-respect du principe de responsabilité contribue à la contamination croissante de notre planète par des substances toxiques et aggrave les violations des droits de l’homme, tels que le droit à la vie, le droit à la santé et le droit à un environnement propre, sain et durable, qui en résultent. Les personnes et les groupes exposés à des produits et déchets dangereux (ci-après désignés sous l’expression « substances toxiques »1) subissent des injustices en matière de reproduction et sont susceptibles d’avoir des déficiences neurologiques et divers types de cancer, entre autres graves problèmes de santé. Cependant, pour les entités qui émettent des polluants toxiques et les autorités qui les laissent faire, l’impunité est la norme, plutôt que l’exception. 2. Pour des millions de personnes dans le monde, l’exposition à des substances toxiques est synonyme de peur, d’anxiété et d’angoisse, de maladie, de handicap ou de mort prématurée et douloureuse. Or, dans leur quête de justice et de réparation, les victimes se heurtent souvent à de lourds obstacles qui entraînent des retards dans les procédures et le déni de leurs droits. Des entraves telles que
- une charge de la preuve déraisonnable,
- des délais de prescription inadéquats et
- des obstacles financiers
entretiennent l’impunité, exacerbent les injustices environnementales et sapent les fonctions préventives, réparatrices et compensatoires des systèmes juridiques. Toutes ces entraves aggravent les violations des droits de l’homme qui résultent de l’exposition à des substances toxiques.
Extraits n° 2 – Plusieurs juridictions ont neutralisé l’iniquité de la prescription.
La Cour européenne des droits de l’homme a offert des réparations aux victimes dans plusieurs affaires ayant trait à des violations des droits de l’homme résultant de l’exposition à des produits et déchets dangereux. Elle s’est également penchée sur la question du droit à un procès équitable dans les affaires ayant trait à des substances dangereuses et sur celle de l’accès à la justice. À titre d’exemple, dans une affaire relative à l’amiante dans laquelle le délai de prescription était mis en question, la Cour a fait observer que, bien qu’il soit légitime de fixer un délai de prescription de dix ans pour assurer la sécurité juridique, il n’y avait pas de période de latence maximale scientifiquement reconnue entre l’exposition à l’amiante et le mésothéliome pleural malin (cancer de la plèvre)15. La Cour a estimé qu’interdire aux personnes souffrant de maladies qui n’ont pu être diagnostiquées que de nombreuses années après l’exposition de présenter des demandes d’indemnisation revenait à les priver de la possibilité de faire valoir leurs droits devant les tribunaux (Jann-Zwicker and Jann v. Suisse, requête no 4976/20, arrêt du 13 février 2024.)
Pollution héritée du passé
97. En 2025, la Haute Cour de justice d’Angleterre et du Pays de Galles a statué que les plaintes déposées par les communautés Bille et Ogale du Nigeria contre Shell pour la pollution par les hydrocarbures héritée du passé étaient recevables, même si les écoulements s’étaient produits des années auparavant, en ce que les faits allégués pouvaient constituer une infraction continue au regard des obligations juridiques de Shell.
La Cour a estimé que chaque jour où les hydrocarbures resteraient sur le terrain d’un demandeur créerait un nouvel intérêt à agir, ce qui signifie en substance que les pollueurs ne peuvent pas invoquer la prescription pour se soustraire à leurs obligations relatives à une pollution héritée du passé.
Extraits n°3 - Charge de la preuve
82. En vue de garantir l’accès à la justice dans les affaires ayant trait à des substances toxiques, les législateurs et les tribunaux examinent les modifications envisageables en ce qui concerne la charge de la preuve et les éléments de preuve requis. Les innovations conçues dans ce cadre s’attaquent aux asymétries entre les victimes et les pollueurs et s’avèrent cruciales lorsque les preuves sont contrôlées par des sociétés ou des États. 83. En 2023, la Cour interaméricaine des droits de l’homme a rendu son arrêt dans l’affaire Inhabitants of La Oroya v. Peru. Elle a estimé, au regard du droit à la santé, qu’il n’est pas nécessaire de prouver un lien de causalité direct entre les maladies contractées par les victimes et l’exposition de ces personnes à des polluants lorsque les éléments de preuve disponibles permettent d’établir que : certains polluants présentent un risque significatif pour la santé humaine.
84. De même, en 2025, la Cour européenne des droits de l’homme a rendu son arrêt dans l’affaire Cannavacciuolo et autres c. Italie, concernant la pollution d’une zone considérable causée par l’incinération et le déversement illégaux de déchets.
La Cour a estimé, au regard du droit à la vie, que les preuves de pollution et du fait que les requérants résidaient dans une zone touchée pendant une période considérable permettaient d’établir l’existence d’un risque grave, véritable et imminent pour la vie, et que les autorités avaient donc l’obligation d’agir.
Elle n’a pas jugé nécessaire ou approprié d’exiger des requérants qu’ils démontrent un lien avéré entre l’exposition à un type identifiable de pollution ou même à une substance nocive et l’apparition d’une maladie précise mettant la vie en danger ou le décès des suites de cette maladie96.
85. Une autre innovation est le renversement de la charge de la preuve. Dans l’affaire Vellore Citizens Welfare Forum v. Union of India and Others (1996), concernant la défense de l’intérêt général et la pollution de sources d’eau, la Cour suprême de l’Inde a estimé que la charge de la preuve incombait au promoteur, qui devait démontrer que ses activités n’avaient pas d’incidence grave sur l’environnement.
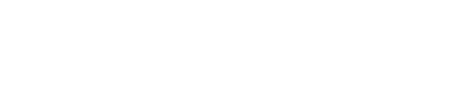
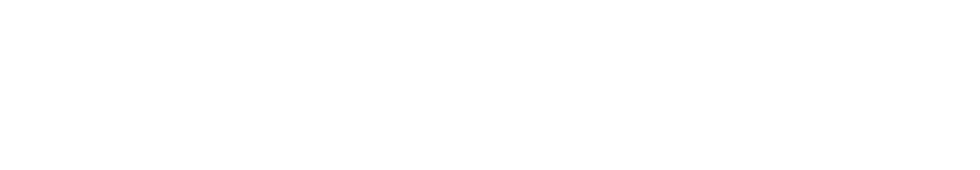

 Un avocat ?
Un avocat ?